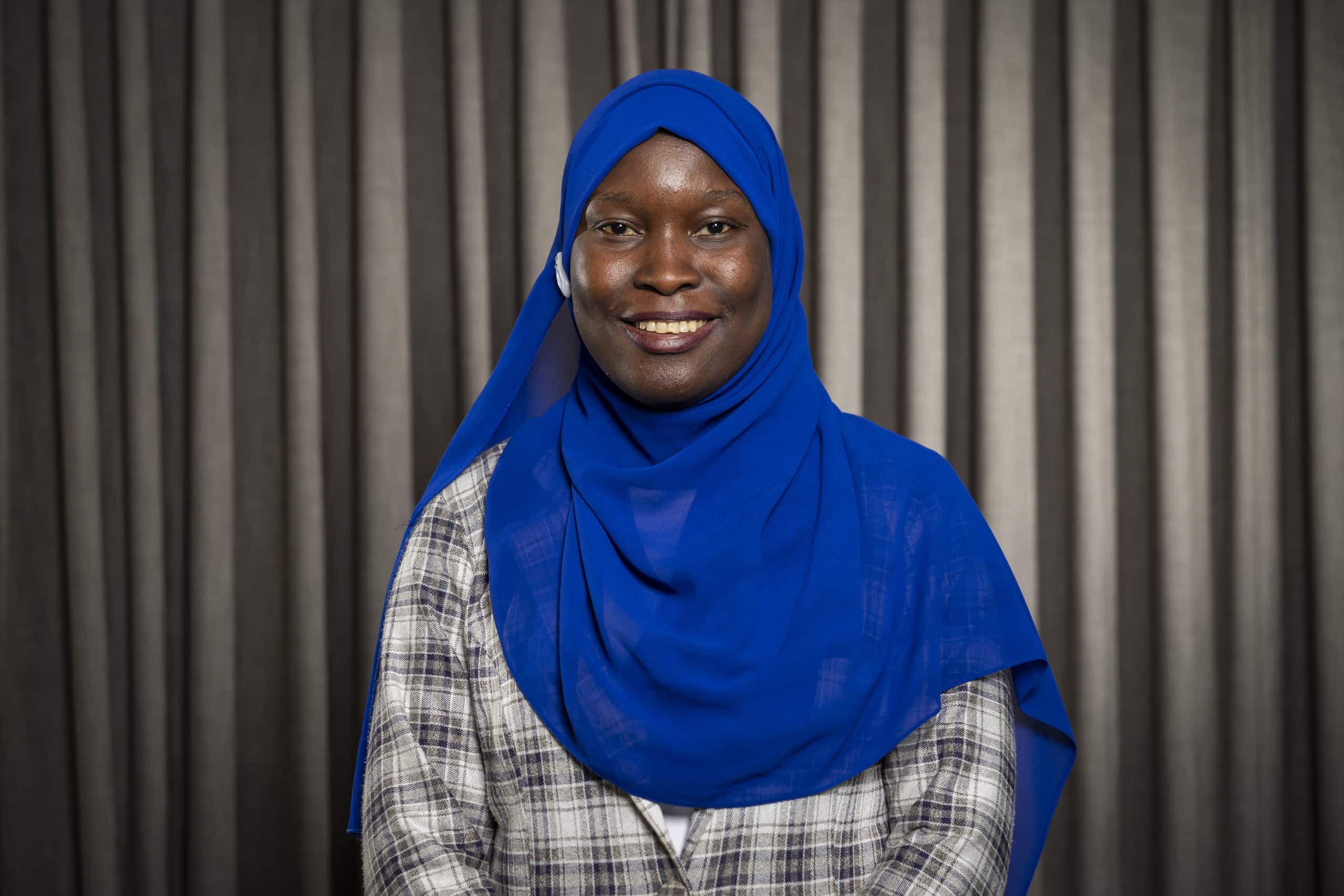Au Sénégal, dans certaines régions, l’eau des nappes phréatiques est saumâtre. Un danger pour la santé des populations, qui font face, mais attendent davantage des pouvoirs publics.
Reportage Maria Pineiro / Le Courrier
Assis sur sa chaise, un vieil homme plonge un gobelet dans un seau rempli d’eau, puis le porte à sa bouche. Nous sommes à Fao, dans la commune de Ndiaganiao, dans l’ouest du Sénégal. A quelque deux heures de route de Dakar, la capitale. En ce début d’après-midi estival, la chaleur est écrasante. A l’entrée du village, les notables se sont réunis sous un arbre pour recevoir Le Courrier. Derrière nous, passe une femme, bidon d’eau sur la tête. En provenance du puits, à quelques centaines de mètres des habitations. Dans le village, il n’y a ni eau courante ni électricité. La population, disséminée dans des concessions familiales, s’approvisionne dans des puits.

A Fao, la population s’approvisionne à un puits dont l’eau, qui n’est pas traitée, n’est pas potable. Photo Maria Pineiro
Pas de financement pour se raccorder
Ici, l’eau douce est une denrée rare. Dans les environs, une majorité de forages ont abouti sur de l’eau saumâtre, plus ou moins salée. «Seuls deux des cinq puits dans les alentours du village fournissent de l’eau douce. L’un est à 300 mètres, l’autre à plusieurs kilomètres», détaille Samba Gningue, le chef du village. Bien que l’eau saumâtre soit impropre à la consommation, elle est parfois bue, si le degré de salinité est bas. Quant à l’eau douce, issue de forages moins profonds, elle n’est pas traitée. Et donc non potable. «Nous buvons cette eau, car nous n’avons pas le choix. Mais cela cause des problèmes de santé, poursuit le notable. Ce sont surtout les personnes âgées, les nourrissons et les enfants qui sont affecté·es par des maux de ventre, des diarrhées, ou de la dysenterie », explique Samba Gningue. Autre mal, très visible, les atteintes à la dentition. Un habitant du village vient spontanément nous montrer sa bouche, les dents sont colorées, les gencives enflammées.
Enfin, en période sèche, il est nécessaire de se rationner, car les puits s’assèchent. Ironie du sort, à 120 mètres de l’entrée du village, une gigantesque conduite d’eau potable s’écoule jusqu’à la mer. La Notto-Diosmone-Palmarin (NDP) traverse et dessert les régions de Thiès et de Fatick, dans l’Ouest du pays. Des zones qui font face à des ressources aquifères salées ou fluorées.
«Notre plus grand souhait, c’est d’être raccordé», s’exclame le chef du village. Mais, explique-t-il, la commune de Ndiaganiao ne finance que les infrastructures situées dans les premiers 20 mètres de la NDP. A Fao, le village devrait donc trouver les fonds pour payer les 100 mètres restants. Pour les habitant·es, des gens très modestes, cela n’est tout simplement pas envisageable. «Nous avons besoin du soutien de la coopération internationale. Nous sommes à la recherche de partenaires», indique plein d’espoir Samba Gningue. Un optimisme qui détonne dans le contexte actuel, à l’heure où les Etats du Nord coupent massivement dans l’aide aux populations du Sud.

Dans raccordement au réseau public, les femmes doivent faire de nombreux allers-retours pour aller chercher de l’eau. Photo Maria Pineiro.
Au coup par coup
Pour autant, la solidarité existe. Dans le chef-lieu de Ndiaganiao, à une vingtaine de kilomètres de là, la mairie a pu raccorder 1400 foyers l’année dernière et mettre en place des fontaines publiques. Une avancée rendue possible grâce à la coopération internationale, ou plutôt l’amitié entre populations. C’est en effet dans le cadre du jumelage de la commune sénégalaise avec la ville française de Saint- Herblain, dans la Loire-Atlantique, qu’ont pu se concrétiser divers projets, par le truchement de l’association Eau Vive Sénégal.
«Les habitants qui ne sont pas directement raccordés s’approvisionnent à des bornes- fontaines», ajoute Bousso Sylla, secrétaire de la mairie. Mais l’eau potable a un prix. Les habitant·es s’arrangent donc au coup par coup. Dans certaines maisons, les membres d’une même famille font robinets et compteurs séparés; ailleurs, les gens boivent l’eau des puits, tirée des nappes peu profondes, donc de mauvaise qualité. «Et cela les rend malades», regrette l’employée municipale.
Habitat dispersé
Dans la commune de Ndiaganiao, qui compte 60’000 habitant·es, la question de l’eau potable reste un défi important, car l’habitat est extrêmement dispersé sur un large territoire. Près de 70% des ménages ne disposent pas encore de l’eau courante à domicile. «Si nous pouvions traiter directement l’eau des forages, cela permettrait de développer l’économie», espère Demba Sène, premier adjoint au maire de Ndiaganiao. Pour pallier le manque d’eau potable dans certaines régions où la pureté des nappes phréatiques est insuffisante, le Sénégal a lancé, en octobre 2024, l’ambitieux projet Autoroutes de l’eau.
D’un coût estimé à 3500 milliards de francs CFA (quelque 5 milliards de francs suisses), il vise à approvisionner en eau les grandes villes et les zones agricoles, notamment dans le but d’atteindre la souveraineté alimentaire. Il s’agira de transférer l’or bleu du lac de Guiers, dans le nord du pays, vers Dakar, Thiès, Mbour et Touba, situées plus au sud. L’objectif est de desservir 11 millions de personnes d’ici à 2050.
L’hygiène, l’autre enjeu
En parallèle des problèmes d’eau potable dans la région, les autorités doivent faire face aux questions d’assainissement et d’hygiène. A l’école Cem Faylar, à quelques kilomètres de Ndiaganiao, étudient un peu plus de 400 filles et garçons. Mais les élèves ne disposent que de trois toilettes, sans eau courante. Elles se situent dans un coin de la cour sablonneuse, surplombée par deux magnifiques baobabs. A quelques dizaines de mètres, sont installés plusieurs robinets. L’école est connectée à la conduite Notto-Diosmone-Palmarin. L’eau sert autant à se désaltérer qu’à se laver les mains et évacuer les déjections. Mais pour ce faire, il faut porter des seaux. Les enseignant·es disposent de leur propre toilette, mais là aussi, pas d’eau courante à proximité. La situation est insatisfaisante de l’aveu de toutes et tous.
Premier adjoint au maire de Ndiaganiao, Demba Sène est également enseignant dans l’établissement et chargé de projet pour l’Association pour le développement et l’éducation au développement (ADED). L’association genevoise, notamment soutenue par la Ville de Genève, œuvre dans la région afin de promouvoir l’assainissement et l’hygiène des mains. Dans l’école, un projet est en cours de réalisation afin d’augmenter le nombre de toilettes et de rapprocher l’eau des lieux d’aisance pour favoriser le lavage des mains et l’hygiène.
Ce dernier aspect est d’autant plus important pour les jeunes filles qui «renoncent parfois à venir étudier dans les périodes de menstruations, explique Demba Sène. Ce qui a des conséquences négatives sur leurs résultats scolaires». Or, l’école est fréquentée par le double de filles que de garçons. Khady et Awa Diouf ont 18 ans. Les jeunes femmes racontent que les toilettes de l’école sont très occupées. «Il y a beaucoup de monde, cela nous gêne. Alors on se retient jusqu’à la maison», témoignent-elles. Un problème, puisque dans cet établissement, les élèves parcourent plusieurs kilomètres depuis leur domicile. Les deux jeunes femmes aimeraient pouvoir disposer de davantage de toilettes. «Et qu’elles soient séparées de celles des garçons», précisent-elles pudiquement.
L’ADED est présente au sein d’autres établissements scolaires de la région. Aux alentours de Mbour, à Thiandène, 600 élèves étudient. Demba Sène nous montre le dispositif phare promu par l’association. Un énorme réservoir d’eau, avec en guise de robinets, des poires à eau. Ici, pas de poignées pour faire fonctionner. «Il suffit de presser la poire vers le haut avec le dos de la main pour que l’eau s’écoule», détaille Demba Sène. Une manière d’éviter que les germes de la paume ne se transmettent via la robinetterie. Le dispositif permettrait de diminuer la contamination de 40%. Si le dispositif est rangé pour la période des vacances scolaires, le directeur, Ibrahim Faye, explique qu’élèves et professeurs ont été formé·es à son utilisation et se sont habitué·es à se laver les mains régulièrement. «Ensuite, les enfants transfèrent ce savoir dans leur milieu, via la famille», détaille-t-il. Dans la région, cinq écoles ont pu être équipées jusqu’à présent, sur les dix choisies au départ. Le projet continue de se développer. Il concerne également les centres de santé afin de limiter la propagation des bactéries dans ces lieux sensibles.
La potabilisation voisine avec le système D
Dans le delta du Saloum, à Fatick, la problématique de l’eau saumâtre et trop fluorée est de l’histoire ancienne. Une usine de traitement a été inaugurée dans la ville en 2019 par la Société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal (SONES). Elle permet de potabiliser 3600 m3 d’eau par jour. Même si les besoins sont de 4300 m3 par jour à l’heure actuelle, pour les habitant·es, le changement est immense. Plus besoin d’acheter de l’eau venue des puits d’eau douce hors de la ville pour la cuisine, la vaisselle ou encore l’hygiène corporelle.
A Darou Rahmane, Samba Mboup, le chef du quartier, nous reçoit à deux pas de l’usine. «Avant, je ne buvais pas de l’eau du robinet, maintenant, oui», témoigne le notable. Seul bémol, à l’entendre, un goût qui n’est «pas toujours agréable» est perceptible. Un fait que confirme Ndeye Dial, voisine de l’usine. «Avant, nous avions beaucoup de problèmes avec l’eau qui était saumâtre. Il fallait soit aller en chercher aux puits plus loin, soit la faire venir par des charretiers, mais cela coûtait cher. Pour nous, l’usine signifie la fin des corvées.» Dans sa famille, on privilégie désormais l’eau du robinet.

A Fatick, plusieurs échoppes proposent de l’eau filtrée, que les habitant·es jugent meilleure que celle du robinet. Photo Maria Pineiro.
Dans d’autres foyers, les familles diversifient les sources d’approvisionnement selon les usages. Elles utilisent tant l’eau du réseau que celle vendue par des magasins spécialisés. Sur le coup des midi, Amadou et Andala, deux adolescents, se dirigent vers une échoppe qui annonce vendre de l’eau filtrée, située non loin de la route nationale. «Pour boire et faire le thé, nous achetons de l’eau filtrée, car elle a meilleur goût», explique-t-il. Dans l’arcade en question, un paravent cache une machine. En face, un robinet est fixé au mur. C’est ici que les client·es remplissent leurs bidons de 10 litres pour 100 francs CFA (le salaire moyen mensuel au Sénégal est de 100’000 francs CFA). «Nous vendons jusqu’à 100 litres par jour», détaille Aïda Lo, la responsable qui explique avoir acheté l’engin, de fabrication chinoise, pour 4,5 millions de francs CFA.
L’arrivée de l’eau potable à Fatick a permis une nette amélioration de la santé de la population, ont constaté les praticiens du centre hospitalier régional. «Avant, il y avait énormément de problèmes d’hypertension, dus à la salinité de l’eau. Cela provoquait des AVC et des problèmes cardiaques, surtout chez les personnes âgées», souligne Cheikh Tidiane Diop, chef du service des soins infirmiers.
Les tout-petits étaient également touchés. Particulièrement sensibles aux germes, les nourrissons rencontraient des problèmes comme la bilharziose, une maladie parasitaire provoquant diarrhées, fièvre ou sang dans les urines. Enfin, les problèmes de dysentrie, d’hépatites et d’intoxication n’étaient pas rares, relève le responsable. «Au niveau sanitaire, cette usine a été une bénédiction», se félicite Cheikh Tidiane Diop.
La Sénégalaise des eaux informe que de nouveaux projets d’usine ne sont pas d’actualité dans la région, mais que des transferts d’eau, par la construction de canalisations, sont à l’étude.
A l’école, les élèves bénéficient d’une eau de première qualité
Dans un autre quartier de la ville de Fatick, l’école de Kalima2 bénéficie de sa propre unité de filtration d’eau grâce à des charbons actifs, du sable et par osmose inverse. Un dispositif promu et soutenu par la Fondation et l’ONG Access to water qui permet tant de désaliniser que d’éliminer des polluants tels que métaux lourds ou fluor. Depuis 2011, ce sont 80 sites qui sont équipés, dont 20 à Fatick. «Nous avons débuté notre activité bien avant l’inauguration de l’usine», relève Badara Dioum, directeur de l’ONG. Le responsable juge que l’eau qui sort des canalisations reste impure et mérite d’être retraitée.
Les aspects techniques sont issus d’une collaboration avec l’EPFL et la Haute école de l’arc jurassien. Aujourd’hui, les machines évoluent vers des engins plus petits et connectés. Chacun peut potabiliser 1500 litres par jour et dépolluer jusqu’à 3000 litres utiles pour l’hygiène corporelle et les tâches ménagères. «Notre plus-value, c’est le suivi, s’enorgueillit Badara Dioum. Nous ne laissons pas nos machines à l’abandon, nous procédons à l’entretien.» Autre aspect primordial, la formation d’employé·es locaux récipiendaires d’un savoir-faire et la création d’emplois. «Aujourd’hui, l’entretien des machines peut se faire de manière autonome au Sénégal.»
Access to water travaille avec des écoles qu’elle équipe gratuitement et des échoppes de vente d’eau à qui il est facturé 40’000 francs CFA par mois pour l’entretien. Françoise Chantal Diouf, la directrice de Kalima2, est extrêmement satisfaite depuis que l’école a été équipée il y a deux ans. «Les enfants préfèrent l’eau traitée. Ils boivent davantage et souffrent moins de maladies et de maux de ventre», témoigne-t-elle. De plus, élèves comme professeur·es remplissent des bouteilles à l’école pour les ramener à la maison, faisant ainsi profiter toute la famille d’une eau de qualité. La directrice se félicite de la facilité d’utilisation de la machine et de son entretien confié à un technicien. Pour ce faire, la fondation reçoit le soutien financier de divers donateur·ices.

Françoise Chantal Diouf, directrice de l’école Kalima2 à Fatick. Photo Maria Pineiro
A Darou Salam, un autre quartier de la ville de Fatick, Moussa Sow gère un point de vente d’eau. «Avant, les habitant·es parcouraient des kilomètres pour s’approvisionner. J’ai pensé qu’il fallait proposer ce service ici.» Son échoppe vend 20 litres d’eau pour 200 francs CFA. L’établissement de Moussa Sow est ouvert tous les jours de 7 à 21 heures. Il reçoit une quarantaine de personnes par jour. «C’est un bon travail pour moi, je gagne de l’argent tout en aidant la population.» Dans le quartier, il y a deux autres vendeurs d’eau, mais il ne craint pas la concurrence, car il estime proposer un produit de qualité. «Si la machine est bien entretenue, les clients sont satisfaits», assure-t-il. Moussa Sow aimerait pouvoir disposer d’une machine avec une capacité de production plus importante. Le gestionnaire du point d’eau se plaint également des factures du service d’hygiène municipal, qui lui ponctionnent 28’000 francs à chaque contrôle semestriel.