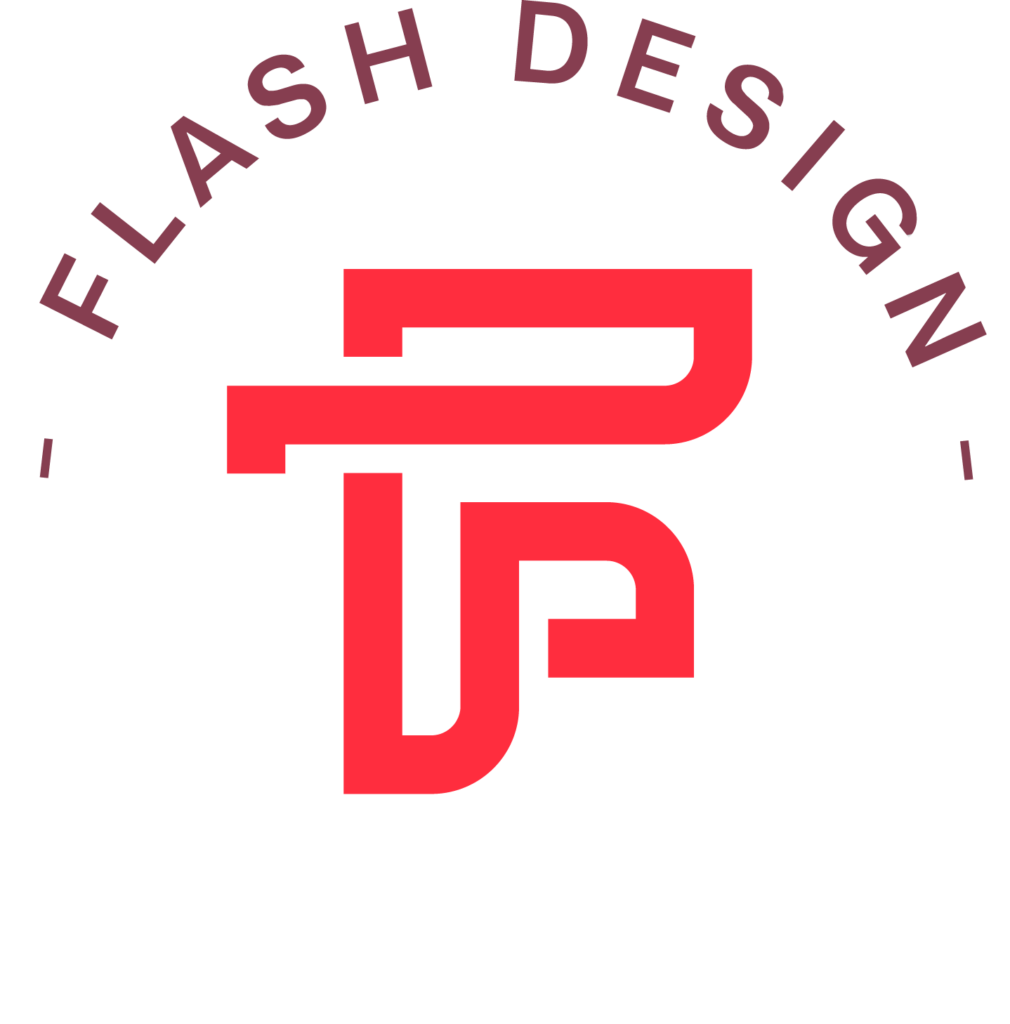Un reportage EQDA
GLOBALISATION • Problèmes de gouvernance et riches terres arables ont fait du Cameroun un véritable eldorado pour les géants de l’agroalimentaire. Face aux monocultures destinées à l’exportation, des paysans luttent au quotidien pour leur survie.
Loum Chantier est un village mangé par la mousse au cœur du Moungo, la terre nourricière du Cameroun qui environne Douala. Dans les rues, les fèves de cacao sèchent à terre avant d’être envoyées au Nord, «chez les Blancs». Avant le voyage, elles seront revendues par plusieurs intermédiaires, renchérissant chaque fois. Au début de cette chaîne, se trouve toujours un cultivateur – et sa famille. Soixante-sept pour cent de la population travaille dans l’agriculture et l’écrasante majorité travaille sur moins de cinq hectares.
Réorientation forcée
Le Courrier est parti en reportage dans ce pays qui doit tout à l’agriculture familiale, mais où les terres arables sont de plus en plus exploitées sous forme de monocultures de bananes, poivre, huile de palme ou coton en vue de l’exportation. Sur place, les noms de Bolloré, Nestlé, ou encore PHP (acronyme pour les Plantations du Haut-Penja, dont la maison-mère est la Compagnie fruitière de Marseille), sont omniprésents.
Loin des techniques industrielles, Jean-Pierre présente sa parcelle. A 52 ans, il a passé la moitié de sa vie au milieu de ses cacaotiers. Il connaît chaque arbre dans cette forêt à la végétation dense, qu’il entretient depuis tant d’années. Lorsqu’il parle de ses cabosses renfermant les précieuses fèves et de ses plantes, c’est presque avec ferveur. «Mais c’est devenu très difficile. Depuis dix ans, surtout. Depuis que le climat a changé. Ici, on se demande si ça va rester ainsi.» Ces derniers mois, les pluies qui se prolongent chaque année lui ont fait perdre 50% de ses cabosses.
«On met des produits traitants, mais ce n’est pas suffisant.» Au sol traînent plusieurs sachets en aluminium. Aucun paysan, dans cette zone, n’utilise de protection. «Ils disent de mettre des masques et des gants, mais ça coûte cher. Par contre, on respecte bien les doses, c’est important.»
Actuellement, Jean-Pierre est endetté. Le cacao lui rapporte de moins en moins, avec des prix oscillant entre 600 et 1500 francs CFA le kilo (1 à 2,50 francs suisses). «J’ai dû me diversifier, alors je fais du poivre à 10 000 francs CFA le kilo. Au final, j’y gagne quatre fois plus.» Le cultivateur n’a jamais entendu parler des labels équitables. Et la fatigue se fait sentir face à des conditions de vie qui se détériorent sans cesse. En fin de discussion, il confie aspirer à ce que ses enfants arrêtent leurs études et viennent l’aider. «Ça m’allégerait.»
Monocultures, et après?
Au retour du champ de Jean-Pierre, les rangs d’une interminable bananeraie défilent, propriété de PHP, qui exploite plus de 5500 hectares dans la zone et exporte chaque année 260 000 tonnes de bananes en Europe.
Une journaliste de Yaoundé, spécialisée dans les questions d’agriculture, explique sous couvert d’anonymat: «Leurs plantations, ce sont comme des sanctuaires. Là-bas on te secoue jusqu’au caleçon pour voir ce que tu portes sur toi.» Elle enrage devant le laxisme du gouvernement face aux pratiques de ces compagnies. «Elles veulent gangstériser nos terres alors que ce sont nos champs non industrialisés qui nous nourrissent.»
Réputées – en mal – pour leur tendance à l’accaparement des sols, certaines firmes reviennent parfois en arrière, après que le mal a été fait. «Hévécam, qui produit du caoutchouc, utilise beaucoup de produits chimiques, qui rendent malades les saigneurs d’arbres. Lorsque les terres ne sont plus rentables, elle organise une cérémonie et rend les terrains, devenus incultivables, aux paysans. Quant aux hévéas qui restent, on ne peut plus rien en faire, le caoutchouc, ça ne se mange pas.»
Nestlé, Bayer et les OGM
Le Cameroun a donc déjà à affronter de nombreux démons. Et de nouveaux combats s’annoncent pour les adeptes d’une agriculture familiale et de proximité. Le 8 septembre dernier se tenait le premier forum national sur les OGM au Hilton de Yaoundé, sous bonne garde de l’armée. L’événement était convoqué par le ministre de l’Industrie et des mines, qui siégeait aux côtés de ses homologues de la santé, de l’agriculture, de l’élevage et de la communication. En bonne place sur les banderoles et la documentation distribuée: les logos de Nestlé, Bayer et Sodécoton, parrains de l’événement.
Les conférences évoquent toutes le besoin d’augmenter la production agricole du pays, par l’intensification et l’industrialisation des exploitations. Nicolas Foudama, du Ministère de l’agriculture, a par exemple défini des objectifs clairs pour les plantations OGM: «la recherche de tolérance à des herbicides totaux» et «l’adaptation à des conditions difficiles (sécheresse, froid)», «le tout dans les conditions de monocultures à grande échelle».
Seule voix discordante lors de ce forum, celle du collectif Attention aux OGM emmené par Bernard Njonga, bien connu au Cameroun pour ses combats en faveur des consommateurs et des petits paysans (lire en page 3). Son groupe a ainsi surgi au milieu du discours inaugural, et a appelé le gouvernement à prendre les intérêts de la population en compte.
Toujours innover
Loin de cette agitation et des géants Nestlé et Bayer, les paysans camerounais, eux, cherchent des solutions viables. Certains, à l’image de William, cultivateur de 35 ans, font le pari de la production locale, sans pour autant rester figé dans des modèles inefficaces.
Pour se rendre à sa ferme de Sikoum, il faut emprunter un chemin que la saison des pluies a zébré de torrents de boue. «Ici, on fait ce que personne n’ose», explique William. Son pari? La tomate, sur une terre où l’humidité dépasse souvent les 90%. Les traces bleues dans ses champs trahissent la nécessité d’utiliser des fongicides. «Il a fallu investir. Faire des tests sur de petites surfaces, échouer, recommencer souvent. J’ai dépensé près de 1 million de francs CFA pour obtenir des avis d’experts.»
Aujourd’hui, c’est William qui donne des conseils. «Beaucoup se sont intéressés à ce que nous faisons ici. Il fallait partager ces expériences. En agriculture, c’est le meilleur moyen pour avancer. Il nous faut aller voir ce que font les autres – pourquoi pas en Europe? – et vice-versa.»
Fier de ses champs, qui regorgent de piments, de laitues, d’aubergines et de tubercules comme le macabo et le manioc, il aspire à transmettre la passion du métier. «Mes forces diminuent. Avant, mon épouse et moi-même ne connaissions ni la pluie ni le soleil. Nous travaillions de 6 heures à 21 heures, à la lampe frontale. J’aimerais que mes enfants continuent le travail et s’épanouissent, sans dettes.» Et pour eux comme pour tous ceux qui viennent voir ses champs, il n’a qu’un conseil: «Il faut se creuser les méninges, oser innover, ne jamais se figer.»