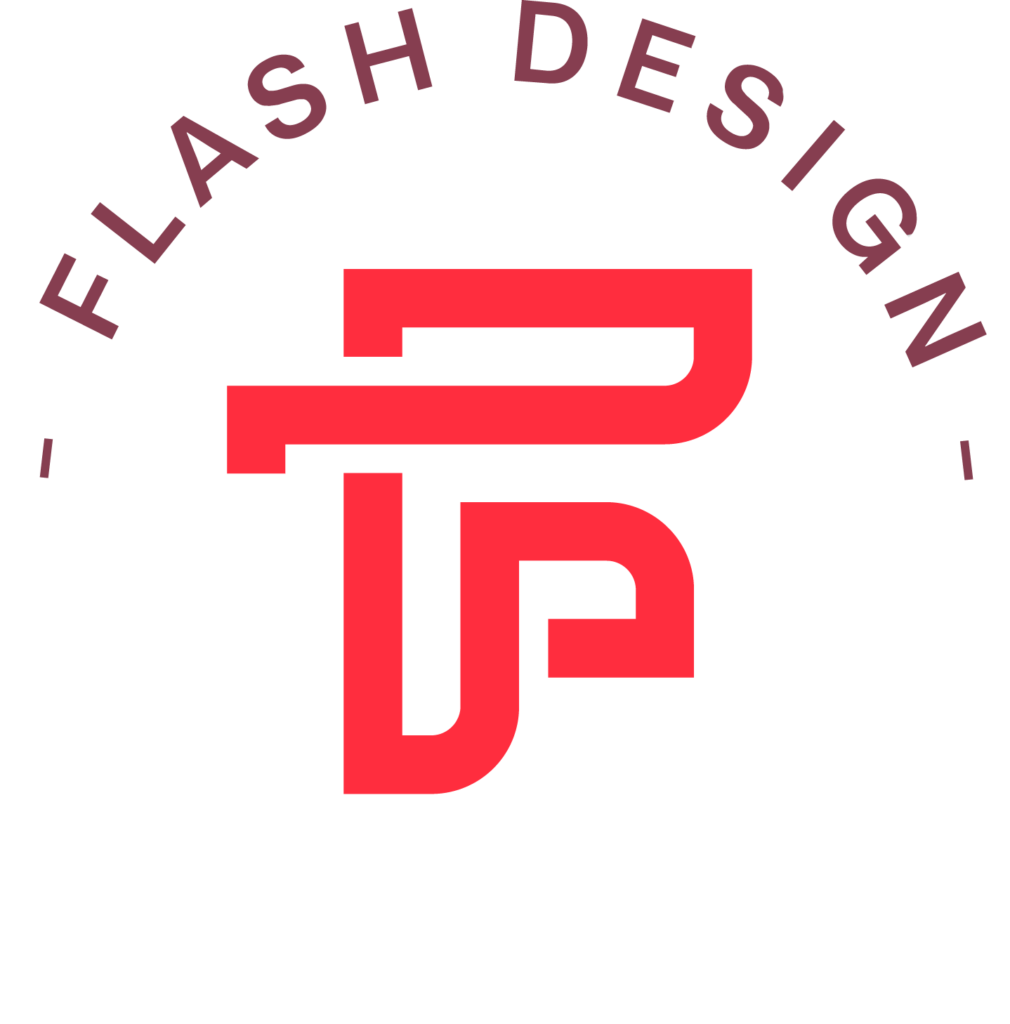Un reportage EQDA
Culture traditionnelle au Tadjikistan, le coton couvre encore aujourd’hui une majorité des terres agricoles du pays. Mais depuis la chute de l’URSS, les paysans n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Des réformes sont en cours et des ONG suisses y participent.
Le cotonnier est traître. Doux, duveteux et d’un blanc tendre, sa culture compte parmi celles qui demandent le plus de travail. La plante vit 200 jours et exige des soins constants, comme le sarclage et l’arrosage. Mais la tâche la plus rude est celle de la récolte qui se déroule justement maintenant, en septembre. Les cueilleurs doivent extirper rapidement mais prudemment les fibres de coton de leur capsule, dont les extrémités sèches coupent comme des rasoirs.
«Nous le récoltions dans des tabliers qui s’attachaient autour du cou. Je vous laisse imaginer combien de fois il fallait les remplir de coton brut pour atteindre notre quota de 40 kilos», se rappelle Firuza, institutrice à Douchanbé, la capitale du pays. Comme beaucoup d’écoliers de l’époque, elle était forcée de travailler aux champs pendant les mois de septembre-octobre.
Au Tadjikistan, le coton est un sujet sensible sur lequel les locaux ne font pas volontiers des confidences. Pendant des décennies, l’or blanc a enrichi les uns et appauvri les autres, et s’est transformé aujourd’hui en une déception nationale. «Nous serions peut-être fiers de cette culture si nous pouvions savoir quel sera son destin. Mais actuellement, notre seule certitude est qu’elle enrichit l’élite au pouvoir et les revendeurs qui font des affaires avec eux», glissent de nombreuses voix.
Popularité en baisse
Nous avons parcouru les environs de Douchanbé avec des collègues du groupe de média tadjik indépendant ASIA-Plus. Dans la zone agricole de Roudaki, où il y a encore quelques années, la blancheur des champs de coton s’étendait à perte de vue, nous sommes accueillis par le jaune des champs de blé. Depuis que les paysans sont plus ou moins libres du choix de leurs cultures, à la suite d’une récente réforme agricole, les plantations de coton diminuent inexorablement. Aujourd’hui, cette culture couvre un peu plus de 60% des terres irriguées du pays (contre près de 100% sous l’ère soviétique).
Sur la route écrasée de soleil, nous prenons la direction de la région de Matcha, dans la province de Soghd, non loin de la frontière avec l’Ouzbékistan. Située dans la vallée de Ferghana, cette oasis fertile est arrosée par les affluents du Syr-Daria. On y cultive du coton, du riz, des fruits, des légumes ainsi que des céréales.
Après la chute de l’URSS, les habitants de Matcha ont connu des temps difficiles. «J’ai vu des gens se faire tuer pour une miche de pain, raconte l’un des collaborateurs de l’ONG «Better Cotton Initiative», basée à Genève, qui a grandi dans cette contrée. J’avais 11 ans, et avec mes copains nous nous rendions en secret en Ouzbékistan pour y acheter du blé et des provisions.»
Depuis, le trentenaire a terminé l’université agricole et familiarise ses compatriotes aux technologies occidentales. Ceux-ci continuent en effet de travailler la terre avec des outils traditionnels comme la pelle et la pioche, faute d’un nombre suffisant de machines agricoles.
L’union fait la force
Nous avons visité l’un de ces cours-séminaires proposés aux ingénieurs agronomes de la région.
«Si vous travaillez en groupe avec la coopérative Sarob, vous n’aurez plus besoin de deux ou trois intermédiaires. Il vous faudra seulement un exportateur et un acheteur international», leur assure Joachim Lenz, un consultant agricole de l’agence allemande de développement GIZ.
«Et comment devenir nous-mêmes des exportateurs?», lui lance une voix dans l’audience. Joachim Lenz écarte les mains. «Pour l’instant c’est compliqué, explique-t-il, mais en joignant vos forces vous pouvez arriver sur le marché, non pas avec quelques petits lots de coton, mais avec un volume de matière première suffisamment important pour intéresser un importateur.»
Les paysans prennent une pause pour se concerter. A Matcha, comme dans toutes les régions rurales du pays, ce sont des hommes d’un certain âge, au visage buriné sous leur calotte, qui décident de tout. Les discussions se font en tadjik, mais on y distingue des mots comme «tracteur», «dollar» et «cotation». Ils choisissent d’accepter l’offre. «Cette année nous en avons la possibilité car nous sommes nombreux à avoir planté la même sorte de coton», déclarent-ils.
«Au Tadjikistan, contrairement aux pays d’Afrique par exemple, les personnes qui travaillent la terre ont reçu une relativement bonne éducation, observe Joachim Lenz. Presque tous savent lire et écrire, et il y en a même qui ont terminé des études supérieures pendant la période soviétique. Mais après la guerre, plusieurs enseignants ou ingénieurs se sont tournés vers l’agriculture car ils ne trouvaient pas de travail dans leur branche.»
Diversification avantageuse
Malheureusement, dans ce pays d’Asie centrale, on peut être intelligent et rester pauvre. En moyenne, une famille de paysans gagne un à deux mille dollars par saison, suivant la récolte et la région. Il leur est toutefois possible d’augmenter leurs revenus en diversifiant leur production.
Jamilya Yusupova, cheffe de projet pour l’ONG Helvetas, travaille avec les maraîchers. «Prenons une famille de fermiers assidue. Sur ses parcelles individuelles, elle peut produire 9 tonnes de concombres, 9 de tomates, et peut encore cultiver des choux, des oignons ou des abricots. Avec la récolte, cette famille reçoit un revenu brut d’environ 6000 dollars. Le revenu net dans le cadre de notre projet était déjà de 2100 dollars en 2014. Cette année, il passera à 2200-2400 dollars», dit-elle fièrement.
Cette année Helvetas a organisé des cours de formation continue auxquels ont participé près de 1500 petits agriculteurs. Depuis le début des activités de l’ONG suisse dans le pays en 2009, quelque 8000 fermiers tadjiks en ont bénéficié.
Les défis du bio
C’est également Helvetas qui a eu l’idée de faire pousser du coton bio au Tadjikistan. Cette culture demande toutefois une certaine patience, puisqu’il faut trois ans de travail avant d’obtenir une première récolte de coton écologique. En effet, les deux premières années, la terre doit se purifier des engrais minéraux et des matières chimiques toxiques.
«Un paysan utilise environ 500 kilos de ces produits par hectare de coton», explique Sherzod Abdurakhmanov, responsable chez Helvetas. Au début du processus, le rendement de la parcelle baisse, et il existe un risque que des agriculteurs qui se sont joints au projet avec enthousiasme se découragent et reviennent à leur style de production habituel.
«En ce moment notre rendement est très bas: en moyenne 2,5 tonnes de coton brut par hectare, alors que pendant la période soviétique il se situait aux alentours de 4 tonnes, poursuit-il. Mais des décennies d’exploitation intensive à grands renforts de pesticides ont abîmé le sol. Si nous n’introduisons pas maintenant de nouvelles approches, les dégâts seront irréparables.»
Le coton bio possède cependant des avantages indéniables: si l’on surmonte les difficultés initiales, il se vend ensuite 20% plus cher sur le marché. Cette année, les paysans tadjiks doivent conclure des affaires portant sur 1100 tonnes de cette marchandise, avec l’aide des spécialistes d’Helvetas. «Nous n’avons pas droit à l’erreur, car le bien-être de nombreuses personnes qui ont cru en nous en dépend», conclut Sherzod Abdurakhmanov.
Accompagner le changement
Selon le responsable, les fermiers tadjiks ne sont pas encore prêts à affronter la concurrence globale. «Pendant l’URSS la production était planifiée. Le paysan devait planter un certain nombre d’hectares de coton et en livrer un certain nombre de tonnes. Sa responsabilité s’arrêtait là.»
Mais les choses ont changé. L’agriculteur doit maintenant décider lui-même quoi semer, se procurer les graines, les faire pousser, procéder à la récolte puis vendre sa production. «Il faut encore des certificats pour prouver que la terre et le produit correspondent aux standards, ajoute Sherzod Abdurakhmanov. Le plus ennuyeux est que tout cela ne garantit même pas que le paysan tadjik sera concurrentiel avec les prix du marché mondial.»
Dans l’absolu, augmenter la production de coton bio ne peut donc être que bénéfique pour les paysans tadjiks. L’intérêt de la part des consommateurs étrangers est considérable. Mais toute la question est de savoir si l’Etat va y trouver son compte. Le coton durable n’est pas utilisé au Tadjikistan, et les hommes d’affaires locaux n’apprécieront pas forcément de voir cette matière première leur échapper pour partir directement en Occident.
Acheteur zurichois refroidi
Cette année, le Tadjikistan devrait récolter quelque 400’000 tonnes de coton brut. Où cet or blanc partira-t-il ensuite? Nous nous sommes penchés sur la question en nous rendant à Winterthur, au siège de la société Paul Reinhart AG. Fondée en 1778, celle-ci achète du coton dans le monde entier. Elle a débuté ses activités au Tadjikistan dans les années 90, où elle a été un temps le plus gros acheteur de coton du pays, en se procurant jusqu’à la moitié du volume total des récoltes.
Mais l’an passé, la compagnie a fermé sa représentation à Douchanbé. «Il était devenu difficile d’y travailler», explique son vice-président, Marco Baenninger. Aujourd’hui, le commerce du coton se concentre toujours plus dans les mains de l’Etat, qui préfère conditionner cette denrée à l’intérieur du pays sans l’exporter à l’étranger.
L’une de ces entreprises de transformation est la fabrique «Olim Textile», propriété de l’homme d’affaires Jamshed Abdulov. Elle a été construite en 2009 avec des crédits de la Banque eurasienne et se trouve à une heure de trajet de Khodjend, la capitale de la province de Soghd. Nous nous y rendons à l’improviste.
Pari sur l’avenir
Après quelques négociations téléphoniques avec leur hiérarchie, les gardes nous emmènent rencontrer le directeur dans son bureau moderne, où trône un Coran sur son socle doré. «Nous produisons du fil à partir de coton à courtes et moyennes soies, nous avons actuellement 500 tonnes en stock», indique Jamshed Abdulov, qui précise que son équipement est allemand et suisse.
Environ 500 personnes, en majorité des femmes, travaillent dans l’usine. Un bus va les chercher dans leurs villages et les y ramène lorsqu’elles ont terminé. L’usine fonctionne 24h/24, avec un tournus de trois équipes. Les ouvrières gagnent près de 100 dollars par mois. Le fil ainsi produit s’exporte en Russie, en Biélorussie, en Italie et en Turquie. L’un des partenaires européens d’«Olim Textile», n’est autre que le fabricant Lacoste.
En théorie, le coton est capable de faire du Tadkjikistan un pays riche. Mais pour cela, il est nécessaire que le gouvernement affiche une volonté politique d’améliorer les conditions de vie de ses paysans et de conserver une importante production de coton sur ses terres. Cet espoir est-il réaliste?
Pour les habitants, le coton était, demeure et restera la principale culture nationale, sans laquelle leur pays est tout simplement inconcevable. Peut-être que le processus de globalisation, dans lequel le Tadjikistan commence à s’inscrire avec l’appui de la Suisse, fera pencher la balance. Mais ce n’est encore que de la musique d’avenir.
(Traduction du russe: Martine Brocard)