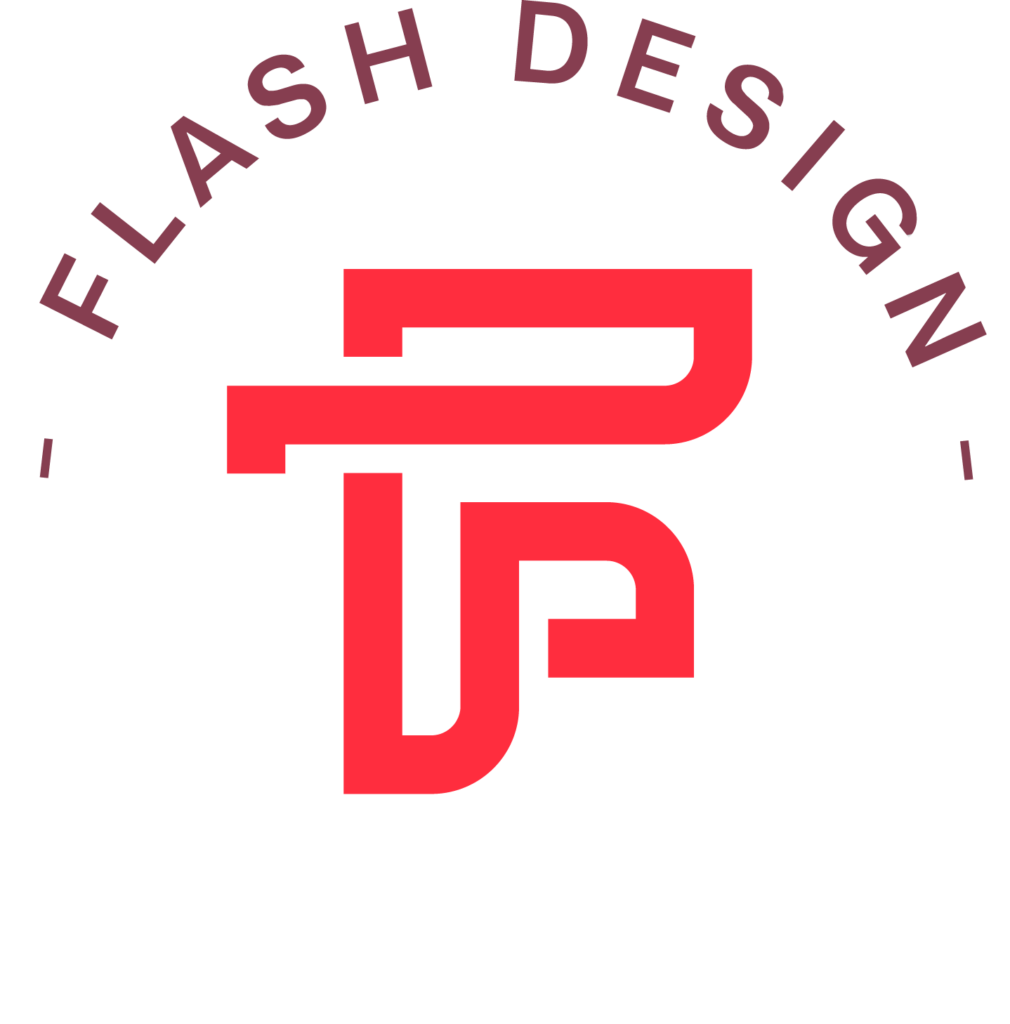UN REPORTAGE AU LIBAN DE SELVER KABACALMAN
Au Liban, la lutte contre les violences conjugales gagne des points mais se heurte au confessionnalisme en vigueur dans le pays. Les associations et ONG féministes le dénoncent et réclament plus de laïcité.
La route paraît interminable. Sous un soleil de plomb, plus d’une quarantaine de minutes s’écoulent. La capitale Beyrouth est loin derrière et les terres deviennent de plus en plus arides. Concentré sur sa route, le chauffeur de taxi s’arrête d’un coup sec: il ne reconnaît plus le chemin. «Quelqu’un viendra nous chercher», rassure Jihane Isseid, responsable de programme au sein de l’ONG Abaad. L’attente sera de courte durée. Une voiture apparaît et nous montre le chemin. Quelques kilomètres et voilà que surgit brusquement une maison au portail énorme, surplombé de caméras: un refuge pour femmes victimes de «violences domestiques», comme on préfère le dire au Liban. Il fait partie des trois centres tenus secrets que gère l’organisation à travers le pays.
Aicha est arrivée dans ce refuge il y a quelques semaines avec ses deux filles. C’est une survivante. Elle a fui son mari et sa famille, grâce à l’aide de ses voisins et des Forces de sécurité intérieure (FSI). «Il m’a menacée de mort. Mes filles m’ont demandé de faire quelque chose. C’est là que j’ai porté plainte», confie-t-elle. Mais cela a pris du temps. Battue par son mari dès le début de leur union, elle subit ses coups depuis 2014. La première fois qu’il a levé la main sur elle, Aicha était enceinte de leur premier enfant. Elle pardonne, à plusieurs reprises, mais la violence ne cesse pas pour autant. Elle porte plainte, sans être soutenue par sa famille. Son mari a passé un mois en prison et pour éviter qu’il ne la retrouve, Abaad a relocalisé la mère et ses filles au Mont-Liban, loin de la Bekaa où vit son entourage.
Il arrive même que l’ONG exfiltre les femmes du pays pour garantir leur sécurité, explique Ghida Anani, directrice d’Abaad. Aicha a entamé une procédure de divorce. Le processus sera long puisqu’elle est musulmane et son mari maronite. Mais d’ici là, elle sera placée dans un refuge de «transition» vers une vie meilleure. Un lieu où elle pourra suivre des formations et des activités pour se reconstruire et devenir indépendante.
Chaque année, Abaad accueille dans ses centres 300 femmes victimes de violences, dont un grand nombre de réfugiées syriennes qui fuient le conflit du grand voisin. Kafa, la plus importante association féministe du pays, dispense au quotidien des conseils juridiques et des aides directes aux femmes et à leurs enfants. L’association travaille aussi étroitement avec les FSI et forme ses agents. En 2018, 1107 femmes y ont fait appel. «Chaque année leur nombre augmente. Cela ne signifie pas forcément qu’il y a plus de violence, mais que l’information circule mieux», explique Rayan Majed, responsable de la communication chez Kafa.
Il n’existe aucun chiffre officiel sur les féminicides ni sur le nombre de femmes qui subissent des violences conjugales. Mais les associations et les ONG traitant de la question sont nombreuses. Et chacune possède sa propre hotline d’aide et ses propres données statistiques. «Cela ne rend pas les choses faciles pour une victime. Elle a plusieurs numéros en tête», relève Ghida Anani.
Un tournant décisif
Petit pays de quelque 6 millions d’habitants (dont 25 à 33% de réfugiés), le Liban a connu un grand tournant sur la question des violences domestiques en 2014. C’est à cette date qu’une loi – la loi 293, dite la loi Kafa – contre les violences domestiques a été adoptée. «Elle incrimine tout abus familial de type physique ou moral et instaure des mesures de protection et d’accompagnement», explique Georges Okais, ancien juge et député du parti des Forces libanaises. Le texte prévoit aussi la création d’une unité spéciale au sein des Forces de sécurité intérieure. Enfin, cette loi permet une injonction de séparation des corps en cas de danger, hors procédure de divorce. «La police a l’obligation d’aller porter secours, sinon elle est sanctionnée», relève Rayan Majed.
Cette loi a cassé un tabou au sein de la société libanaise, poursuit l’activiste. «Le silence et la peur ont laissé place à la libération de la parole. Les femmes venaient après avoir subi des années et des années de violences. Elles arrivent désormais beaucoup plus vite.» Le nombre de plaintes en justice a augmenté depuis l’instauration de cette loi, confirme Kafa. Pour Georges Okais, le travail des ONG et celui des médias a grandement contribué à lever «ce rideau de fer».
Des batailles restent à mener
Le bilan n’en est pas moins contrasté, car les procédures sont encore trop complexes, selon Kafa. Et de nombreux aspects de la loi posent problème – elle est trop vague et certains points ne sont pas abordés. A l’origine, le texte proposé par Kafa concernait spécifiquement les femmes, mais à la suite des oppositions religieuses, il a été élargi à l’ensemble des membres de la famille, prenant en compte aussi le personnel de maison. Pour Kafa, les violences envers les femmes doivent être sujettes à une juridiction spécifique car «c’est un crime en soi», et liées à des sanctions appropriées. Autres points: les violences commises par les ex-époux ne sont pas prises en compte dans cette loi 293 et, à ce jour, seul le viol extraconjugal est incriminé par le code pénal.
Aussi, les hommes violents se cachent souvent derrière l’accusation d’adultère, considéré comme un délit au Liban. «L’homme dit ‘elle m’a trompé donc je l’ai battue’. Mais cette excuse ne passe plus dans certains commissariats», explique Rayan Majed.
Le confessionnalisme, le cœur du problème
Kafa fait aussi campagne pour un code civil unifié et égalitaire du statut personnel. La plupart des 18 confessions officiellement reconnues au Liban bénéficient de droits constitutionnels. Ainsi, il n’existe pas moins de quinze codes communautaires de statut personnel, qui établissent les relations familiales et les interactions homme-femme. Les affaires familiales – mariage, divorce, garde des enfants, etc. – ne dépendent donc pas de la justice civile mais des tribunaux confessionnels, indépendants de l’Etat.
«Ces lois sont discriminatoires à l’égard des femmes», martèle Rayan Majed. Lina Abou-Habib, directrice exécutive de l’ONG Women’s Learning Partnership au Liban et experte des problématiques hommes-femmes, abonde: «L’homme puise son autorité au sein de ces textes. Ces codes communautaires instaurent une hiérarchie. L’homme est à la tête de la famille comme le Christ est à la tête de l’Eglise, disent les catholiques par exemple. Au Liban, la femme n’est pas considérée comme une adulte. Elle ne peut par exemple pas ouvrir de compte pour ses enfants avec son propre argent.»
«Ces lois sont donc aussi une forme de violence exercée sur les femmes. Il n’y aura pas de réelle libération des femmes si ces lois-là ne changent pas», soutient Rayan Majed.
Mais la bataille est difficile dans un pays où les confessions ont des droits inscrits dans la Constitution et sont fortement ancrées en politique. Le pays est dirigé par trois confessions majoritaires: un président maronite, un premier ministre sunnite et un président d’assemblée chiite. Et le parlement est réparti entre chrétiens et musulmans. «Nous ne nous faisons aucune illusion. Le combat sera dur. Mais nous devons le mener. Au-delà des confessions, nous nous battons contre le patriarcat», conclut Rayan Majed.
Pour Lina Abou-Habib, le confessionnalisme est clairement «la source du problème», mais supprimer la mainmise des confessions sur la famille reste compliqué. «Il faut se rendre compte que c’est un business. Les communautés religieuses ne donnent pas leurs services gratuitement. Quand on se marie, quand on divorce, (…) c’est de l’argent. Il y a toute une économie derrière, qui n’est soumise à aucune forme de taxation ou de contrôle.»
Selon l’avocat et ancien député Ghassan Moukheiber, membre de la commission qui a établi la loi 293, il est impossible de supprimer les droits confessionnels sans réformer la Constitution dans son ensemble. En revanche, il serait possible de rajouter un code entièrement laïque, destiné aux personnes ne voulant pas se soumettre à l’une des quinze lois religieuses. Autre solution envisageable: améliorer les codes communautaires déjà existants, comme relever l’âge du mariage par exemple.
Miser sur l’éducation
Mais le spécialiste de droit rappelle: les lois n’ont jamais empêché les criminels de commettre des crimes. «Le plus important est l’accompagnement social et éducationnel.» Le député George Okais plaide aussi pour un meilleur curriculum scolaire: «Il faut enraciner la non-discrimination, la non-violence et l’égalité hommes-femmes dans les mentalités des jeunes générations.» Mais un problème subsiste: «Au Liban, les écoles publiques sont de mauvaise qualité et les privées sont aussi dans les mains des communautés religieuses. Elles ne font que reproduire des inégalités», soutient Lina Abou-Habib.
Le cheikh musulman Firas Ballout, qui est contre l’établissement d’un code civil de statut personnel, estime que les chefs religieux ont toutefois un rôle à jouer pour éradiquer ces violences: «Ils doivent accompagner les couples avant et pendant leur mariage, expliquer les comportements à avoir dans leur prêche du vendredi et dire ce qu’il est bon ou pas de faire aux plus jeunes, dans les écoles. Ceux qui frappent leur femme ont une interprétation erronée de la religion.»
Dans tous les cas, «le mouvement féministe a bousculé les fondations du pouvoir religieux», explique Lina Abou-Habib. Et de poursuivre: «Le combat vient de commencer. Cette loi ouvre la voie à d’autres demandes, comme le droit pour les femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants, car pour l’heure elles ne peuvent pas le faire.»