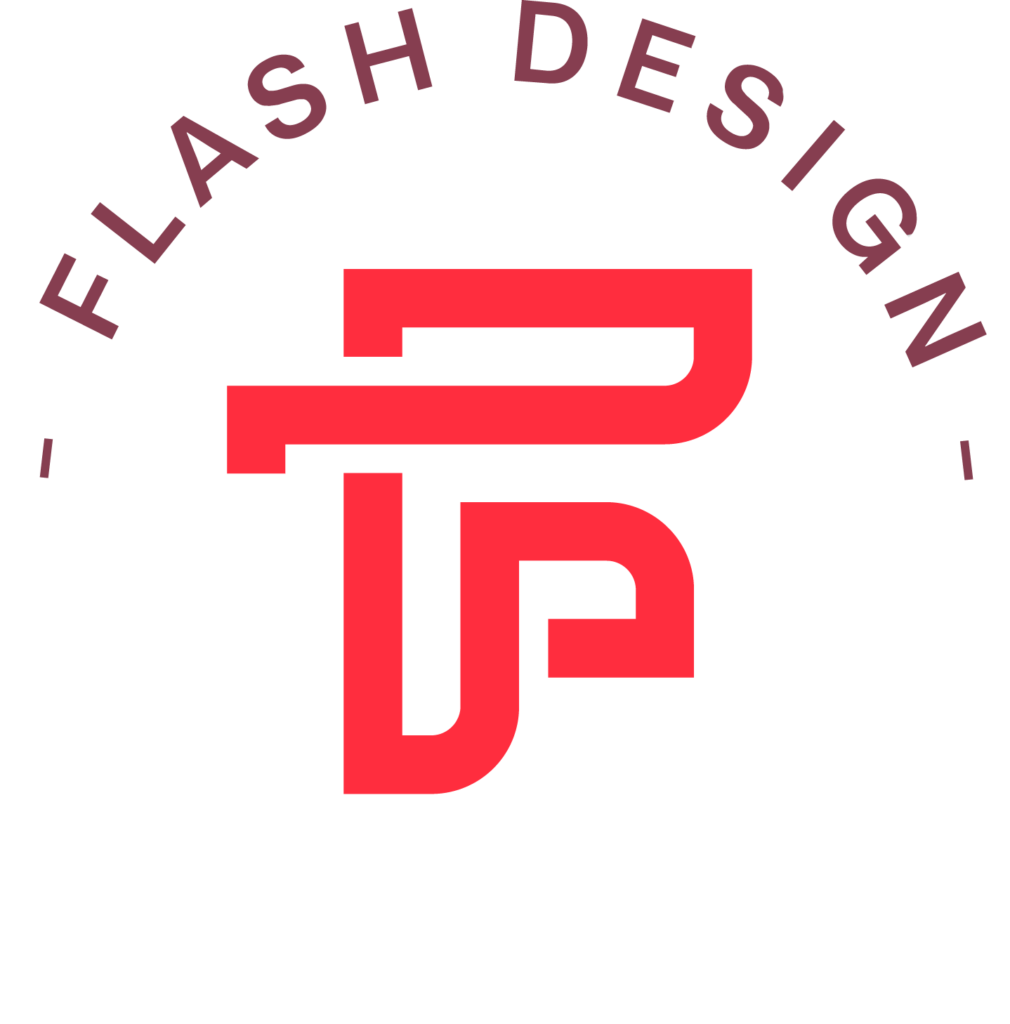LE REPORTAGE DE PAULINE CANCELA A PHNOM PENH

SECURITE ALIMENTAIRE • Une enquête officielle à révélé la présence d’un très grand nombre de produits toxiques dans l’alimentation au Cambodge. Sans une vraie politique agricole et l’application des normes d’importation, le pays pourrait vivre une catastrophe sanitaire.
Des crevettes au formol et des choux gorgés d’acide salicylique. Voilà à quoi seraient réduits quatorze millions de Khmers selon une récente étude de l’Académie royale de Phnom Pehn. La présence de produits toxiques et de pesticides extrêmement nocifs pour la santé a été détectée sur l’ensemble des étals du royaume. Véritable pavé dans la mare, l’enquête relayée par les médias locaux en avril 2011 aurait réveillé le gouvernement du premier ministre Hun Sen, qui étudie actuellement un projet de loi de circonstance. Les consommateurs commencent, eux, à se fédérer afin de faire valoir leur droit à la sécurité alimentaire. La gravité de la situation a été relevée dans un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le Cambodge ferait face à l’un de ses plus gros défis de santé publique, plus que la Thaïlande ou le Vietnam.
Les conclusions de l’étude, menée en 2009 par la chimiste Chek Sotha, sont effrayantes: la quasi-totalité des légumes analysés en provenance des marchés, comme le liseron d’eau ou le haricot, contenaient cinq pesticides prohibés par la plupart des législations en vigueur – parathion méthyl, mévinphos, monocrotophos, méthomyl et endosulfan. Et chez 68% des producteurs investigués, du borax ou de l’acide salicylique a été retrouvé dans le poisson séché, les calamars, les nouilles et le pâté. Plus terrifiant encore, la moitié des revendeurs de crevettes et de calamars ont utilisé du formol pour la conservation des fruits de mer. A titre d’exemple, le borax est employé pour la préservation du poisson qui voyage plusieurs jours jusqu’aux marchés de province. «Lorsqu’il est utilisé par les marchands pour la fabrication du pâté, il répond à un souci d’économie, ajoute Chek Sotha. Il permet de mettre moins de viande et de faire coller le tout plus facilement.» D’habitude, on recourt à ce sel toxique dans la métallurgie (pour la soudure) et dans l’industrie nucléaire. On le trouve aussi dans la porcelaine ou comme alternative à l’eau de javel. Selon certains blogueurs, il entrerait même dans la composition de la mort-aux-rats!
Importation illégale
Alors qu’une loi établit la liste des produits toxiques réglementés ou interdits au Cambodge, les résultats sont révélateurs. «Une législation a beau être en projet, l’enjeu principal reste l’application du droit», estime Keam Makarady, du Centre d’étude et de développement agricole cambodgien (CEDAC). En tant que directeur du programme Environnement et santé de l’ONG, M. Makarady a recensé plus de huit cents produits toxiques sur le marché cambodgien en 2010. «Une bonne moitié sont normalement prohibés», déplore-t-il.
Comment expliquer l’inefficacité des organes étatiques de contrôle? Le chercheur s’est laissé dire que le gouvernement manque de moyens pour appliquer une surveillance régulière aux frontières. Même discours au Ministère de l’industrie. Pour Cheng Uddara, directeur du département des normes industrielles, il n’existe aucun budget pour ce genre d’opération – que ce soit de saisie ou d’analyse en laboratoire. «La tâche est rendue davantage complexe par le manque de coopération entre les ministères», regrette le fonctionnaire, se référant au CAMcontrol, un organe qui appartient au Ministère du commerce. Depuis l’ouverture des frontières économiques, en 1993, l’importation des intrants agricoles et des produits chimiques – surtout en provenance du Vietnam et de la Thaïlande – échappe donc à tout contrôle.
Psychose alimentaire
De quoi donner du crédit à la psychose alimentaire ambiante à Phnom Penh, silencieuse mais bien réelle. «J’ai peur de tout ce que je mange», confie Chantha, 22 ans, employée dans l’hôtellerie. Elle doit «laver frénétiquement» tout ce qu’elle achète. «Beaucoup de gens se plaignent à Phnom Penh, poursuit la jeune Khmère, mais personne ne sait exactement de quoi il retourne.» En témoignent des diarrhées inexpliquées, des insuffisances rénales, des problèmes d’estomac. «Surtout chez les jeunes», confirme la professeure Chek Sotha. Elle-même avoue ne plus manger aucun produit de la mer depuis 2006, année de sa première enquête en la matière. «L’ingestion régulière de ces substances provoque le cancer de l’intestin, parfois la mort, continue-t-elle. Ce qui pose un sérieux problème de santé publique.» Mais, faute de statistiques, il est impossible de vérifier les cas d’empoisonnement dus aux substances telles que le borax ou le formol. Directeur du département sanitaire de Phnom Penh, Sok Sokun regrette qu’aucune étude n’ait été menée dans cette direction. Cela dit, la Ville, bien consciente de la situation, mène des campagnes d’information auprès des restaurateurs et des marchands depuis 2009. Déjà deux tiers des restaurants de Phnom Penh auraient cessé de recourir au borax, selon le fonctionnaire. Puisque «normalement, personne ne désire mourir», selon la formule de l’académicienne Chek Sotha, les raisons de la contamination alimentaire sont principalement fonction de l’ignorance et de la précarité des producteurs (lire ci-contre). Peu éduqués, pauvres, la plupart des riziculteurs, pêcheurs ou maraîchers sont pieds et poings liés par la nécessité du rendement. «Ils n’ont souvent pas d’autre choix que de recourir à des produits toxiques», précise Keam Makarady. Par manque d’expérience ou par manque de moyens. Au marché de détail, personne ne souhaite témoigner. Seule une maraîchère du marché de gros – une «institution» qui trône sur des bouts de trottoirs de la capitale – accepte de répondre. Ici s’entassent des quantités astronomiques de légumes arrivés tout droit du Vietnam. A côté d’elle, des concombres d’une taille suspecte: «Ceux-là viennent de l’étranger, souffle-t-elle. Les légumes vietnamiens sont bourrés de toxiques, ce qui les rend plus beaux et plus frais après un long transport.» Le borax? La vieille dame ne connaît pas… En revanche, comme tous ses pairs, elle a entendu des bruits de couloirs, et vu «des marchands mettre une substance qui ressemble à de la farine sur le fromage pour le blanchir. Je sais que c’est toxique. Moi, je ne mange que ce que je produis, sinon je tombe malade, c’est sûr!»
570 kilos de borax saisis
Si l’enquête de Chek Sotha se révèle particulièrement alarmante, la chimiste tempère toutefois. Depuis sa première analyse en 2006, les quantités de produits toxiques trouvés dans les aliments auraient significativement diminué. Bien qu’aucune campagne de sensibilisation n’ait encore été menée par le gouvernement, des signes permettent un certain optimisme. «Depuis la publication des résultats, le CAMcontrol a saisi 570 kilos de borax à Phnom Penh», se réjouit la scientifique. Elle attend beaucoup de la nouvelle législation en préparation au Ministère de l’agriculture. «Il n’y a pas de raison que la situation ne s’améliore pas. L’éducation est l’ingrédient essentiel pour atteindre une utilisation intelligente des produits.» Car beaucoup de pesticides ne présentent pas de danger pour la santé tant que les quantités maximums légales sont respectées. D’où l’importance de la sensibilisation du public. D’ailleurs, face à l’ampleur du «désastre», le CEDAC organise depuis quelques années des petits ateliers de consommateurs. Quelques programmes de formation en agriculture existent, mais restent minoritaires dans un pays qui compte 77% de sa population dans les campagnes. «La solution doit venir des individus eux-mêmes, estime Keam Makarady. Il ne faut pas hésiter à créer des associations de consommateurs. Cela prend du temps, mais c’est déjà en train de naître au Cambodge.»
Collaboration: Leang Delux.
COMPLÉMENT D’ARTICLE :
Apprendre les bases d’un métier

En parallèle à l’accueil des enfants, la fondation Bambi a développé, depuis l’an 2000, un programme d’amélioration des conditions de vie de la famille intitulé, selon son acronyme espagnol, Promefa. Les bénéficiaires sont sélectionnées en fonction de leur volonté de s’en sortir. Selon les profils, le programme s’articule autour de trois axes. Une formation de base (lire, écrire, compter) qui s’impose d’autant plus pour des mères issues du milieu rural, sans formation spécifique. Ensuite, une formation professionnelle qui doit permettre de travailler. Les participantes doivent aussi financer 10% du montant de leur inscription. Le cours de couture représente ainsi un cursus de 80 heures sur cinq semaines. La période de formation fait l’objet d’un suivi partagé entre l’assistante sociale et le professeur. En plus des cours, Bambi prend en charge le coût des transports publics entre l’habitation et l’atelier et fournit un marché alimentaire pour la subsistance de la famille. Enfin, l’octroi d’un microcrédit (50% de l’achat du matériel) favorise le démarrage d’une activité indépendante (couture, manucure, coiffure…).
Grâce à ce dispositif, les mères peuvent sécuriser leurs revenus, donc la vie des enfants. «Pour certaines, la démarche permet aussi de sortir de la prostitution», souligne la psychologue Erika Pinzon. Celles qui cherchent du travail à l’issue de leur formation bénéficient d’un appui à leurs recherches d’emplois. En douze ans, ce programme a permis à 3200 parents, en majorité des mères célibataires, de reprendre pied dans l’existence.
« Les agriculteurs manquent de formation et de capital »
Sur les douze millions de travailleurs ruraux que compte le Cambodge, le Farmer Natural Net (FNN) représente à peine 1,7% de la population paysanne. Mais l’influence de ce réseau d’associations agricoles, membre du mouvement international Via Campesina, s’étend de façon exponentielle. La coopération paysanne est très récente dans ce pays d’Asie du Sud-Est qui n’a ouvert ses frontières économiques qu’à la suite de la victoire de l’opposition royaliste en 1993. Résultat: engrais chimiques et pesticides sont apparus au royaume il y a quinze ans. Après un engouement généralisé autour de ces nouveaux outils, les paysans se sont confrontés à des investissements toujours plus lourds.
Depuis 1998, le FNN promeut la pratique d’une agriculture durable et exempte de produits chimiques, l’octroi de crédits d’investissement, la création de coopératives et assure la liaison entre les producteurs et les marchés. Aujourd’hui, le réseau comprend mille cent sept associations de paysans dans plus de mille villages. D’un point de vue national, cela représente un peu plus de quarante mille familles. Retour sur ces quinze dernières années avec Uon Sophal, président du FNN, et Pan Sopheap, directeur exécutif et coordinateur de la fédération. Agriculteurs, ils ont tous deux eu recours à des produits toxiques.
Comment expliquez-vous l’utilisation excessive des produits chimiques dans l’agriculture cambodgienne?
Uon Sophal: Après la chute de Pol-Pot, nous héritions d’une économie planifiée. Aucun produit n’était importé. Travailler la terre se révélait assez difficile. Quand les pesticides et les engrais sont apparus sur le marché, c’était la fête. On se réjouissait de les utiliser parce qu’ils permettaient un meilleur rendement. Du coup, certains mettaient jusqu’à 300 kilos de produits sur un hectare, ce qui est astronomique.
On dit que les paysans ne savent pas ce qu’ils utilisent. Etait-ce votre cas?
U.S.: Oui. C’est bien le problème. Les étiquettes étaient en vietnamien, en thaï, parfois en anglais. On était à la merci des vendeurs du marché qui nous poussaient à la consommation. C’est toujours le cas pour la majorité des producteurs khmers. Partout, les paysans se plaignent, au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie…
Quels problèmes rencontrez-vous?
U.S.: Premièrement, l’utilisation de ces produits n’est pas durable. Chaque année, on doit dépenser plus d’argent pour s’en procurer, vu qu’il faut en répandre chaque fois plus car la terre s’y habitue. Sans parler du fait que cela détruit complètement l’environnement. S’ajoute à cela que les récoltes contaminées se retrouvent en premier lieu dans les assiettes de ceux qui les produisent.
Vous-mêmes avez-déjà été malades?
Pan Sopheap: Quand j’ai entendu parler des risques liés à l’utilisation de l’engrais chimique, je me suis souvenu du nombre de fois où j’avais été malade, sans savoir pourquoi. J’avais très souvent mal au ventre.
U.S.: Aujourd’hui, je ne mange que des produits de la fédération. Si je ne connais pas la provenance d’un chou, je ne le mange pas. Pour l’anecdote, plusieurs familles se réservaient un bout de terre exempt de substances chimiques destiné à leur consommation courante, de peur d’attraper quelque chose.
Comment avez-vous réagi?
U.S.: Grâce au travail de sensibilisation du Centre d’étude et de développement agricole cambodgien (CEDAC), nous avons pu réduire de moitié le recours à la chimie. Cela a influencé également des gens qui ne font pas partie du FNN.
P.S.: Il est impossible de stopper complètement l’usage de produits chimiques à l’échelle nationale, mais le minimiser est déjà bien. Nous essayons d’apprendre aux membres à utiliser les ressources naturelles de leur communauté pour produire de l’engrais au lieu de fertilisants chimiques. La plupart sont complètement passés à une production biologique.
Quelle solution envisagez-vous pour que le Cambodge passe à une agriculture saine?
U.S.: Les paysans n’ont que de petites terres, il suffit donc de former les exploitants. Ensuite, il faut mettre en place des systèmes d’irrigation efficaces sur les rizières afin d’intensifier la production et d’augmenter le revenu familial. Enfin, il faudrait des subventions du gouvernement et un mécanisme de crédits avec des taux d’intérêt très bas. Nous manquons de capital pour investir.
P.S.: Il faudrait élever plus de vaches pour produire plus de purin. Le compost permettrait aussi d’améliorer la qualité des sols. Nous n’avons pas besoin de grand-chose, tant les surfaces sont petites.
Ne craignez-vous pas la venue de grosses exploitations agro-industrielles?
U.S.: Pour l’instant, il n’y en a pas au Cambodge. La priorité du gouvernement devrait être très claire: que les petits producteurs puissent se nourrir correctement, sans être malades et sans dépenses excessives. Les possibilités d’exportation devraient venir seulement ensuite.
Ya basta !
Depuis des décennies, le pays concentre une violence armée imputable à de nombreux acteurs aux motivations politiques, criminelles et étatiques. Cette géographie de la guerre dessine une «autre Colombie», lointaine, oubliée, qui surgit à la face du monde lors de faits divers dramatiques et spectaculaires (prises d’otages d’Ingrid Betancourt ou du journaliste Roméo Langlois, prise du palais de justice de Bogota par les guérilleros du M 19 en 1985, mort du célèbre narco-trafiquant Pablo Escobar en 1993…). Sur place, cette violence et ses conséquences nourrissent des études et diverses initiatives.
Ainsi, en 2011, la Casa de la mujer (La Maison de la femme) a fait travailler des femmes déplacées en prenant la photographie comme support créatif. Il s’en est suivi la publication d’un ouvrage «Memoria soy yo» («La mémoire, c’est moi) «pour que certaines femmes puissent réinvestir les moments douloureux de leur propre histoire», confie Olga Amparo Sanchéz Goméz, directrice de la Casa de la mujer. De même le grand hebdomadaire colombien «Semana» a publié récemment «Victimas» un recueil de photos de presse qui témoigne des violences couvrant la période 1985-2013. Enfin, le Centre national de mémoire historique (CNMH) a présenté, en juillet au président Santos, un énorme rapport de 430 pages intitulé «¡Ya Basta!» («ça suffit! Mémoire de guerre et de dignité»). Un document de fond disponible au téléchargement (en espagnol) sur le site du CNMH: www.centrodememoriahistorica.gov.co
Auprès de populations indigènes
Dans le concert des structures à l’œuvre au secours des déplacés de Colombie, l’ONG Diakonie, proche de l’Eglise évangélique allemande, se singularise particulièrement. Elle a pour vocation d’intervenir en cas de catastrophes naturelles dans toute l’Amérique du Sud. Sauf en Colombie, où elle concentre son action sur les indigènes du Cauca, au nord du pays. Elle s’est donné pour mission de protéger jeunes et enfants pour éviter les recrutements forcés. Il s’agit de la plus grande communauté du pays, de la mieux organisée et structurée car dépositaire d’une tradition de lutte. «Nous nous efforçons de l’aider dans sa résistance en instaurant des «zones de tranquillité» maintenues à l’écart des armes de tous les camps, pour qu’elle conserve son territoire historique convoité pour ses richesses naturelles», explique María Mercedes Duque López, coordinatrice des programmes.
COMMENTAIRE – Le grand écart colombien
Hormis les exploits de quelques cyclistes affûtés, la renommée de quelques buteurs talentueux ou la qualité de ses cafés, la Colombie souffre d’une image brouillée.
Brouillée par une violence historique dont les racines remontent en 1948 et à l’assassinat non élucidé du candidat à la présidentielle Jorge Eliécer Gaitán. Sa mort déclencha des journées d’émeute à Bogotá, ouvrit une décennie de violence entre conservateurs et libéraux causant entre 200’000 et 300’000 morts et présida à la fondation des groupes de guérilla marxiste. Ceux-là même qui défient le pouvoir et la propre violence de son appareil répressif, malgré les négociations de paix ouvertes à Cuba.
A ce confit primaire, se sont rajoutées les exactions des narco-trafiquants soucieux de préserver leurs zones de non-droit et des groupes paramilitaires œuvrant souvent pour de grands propriétaires terriens cherchant à agrandir leurs domaines. Si bien que cette guerre civile que les Colombiens appellent «le conflit» reste un phénomène rural.
Aujourd’hui, la Colombie suscite des convoitises en raison des richesses de son sous-sol, mais le pays demeure contraint au grand écart. L’Etat reste faible et la société l’une des plus inégalitaires au monde. Alors, le pays aura du mal à s’arrimer au peloton des «émergents» car son développement repose sur une base sociale étriquée, une classe moyenne balbutiante, des mécanismes de redistribution insignifiants et des infrastructures inexistantes. Ainsi, même en cas de paix, le fardeau des millions de «desplacidos» pèsera pendant des décennies.
Plusieurs foyers dans le pays

Le Foyer Bambi de Bogotá a été inauguré en 2011 et réunit trois anciennes structures sur un seul site. Il héberge 120 enfants en régime d’internat. Ils sont issus de familles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins vitaux pour diverses raisons (pas de revenu fixe, absence d’habitation, risque de violences sociales, carences éducatives…). Il reçoit également 180_enfants en accueil de jour. Ils proviennent pour la plupart de familles de vendeurs ambulants, de recycleurs ou de travailleurs sexuels, «car pour bien des jeunes femmes déplacées, le risque de tomber dans la prostitution reste élevé», relève Rocio Cepeda, coordinatrice nationale des programmes sociaux. Pour les gestionnaires de la fondation comme pour leurs répondants de l’Institut colombien pour le bien-être familial (ICBF), il apparaît désormais comme un exemple à suivre pour l’évolution de ses autres implantations.
Bambi est également active dans les villes de Darién, Medellín (deux foyers) et Cali (trois sites). Dans cette dernière ville, «la fondation souhaite désormais répliquer l’expérience réussie de Bogotá en construisant un nouveau foyer», explique Sabine Rosset, porte-parole de Bambi. L’ensemble de ces installations permet d’accueillir un millier d’enfants par an, offrant un précieux répit aux noyaux familiaux, qui peuvent ainsi se stabiliser. Néanmoins, la demande émanant des hôpitaux, des églises et du bouche à oreille des mamans impose désormais une liste d’attente. Enfin, les possibilités d’adoption des orphelins ont été rendues plus difficiles par le législateur.
Le discours féministe se pollinise, se diffuse peu à peu
Les femmes colombiennes paient-elles un lourd tribut au conflit?
Si l’on considère les femmes seulement comme victimes, on évacue la dimension politique de la question. Les paramilitaires et la guérilla ont élaboré des visions différentes de la femme.
Qu’en est-il chez les paramilitaires?
Pour les paramilitaires, on dispose d’études et de témoignages recueillis dans la région Caraïbe. Le rôle des hommes et des femmes se structure de manière très verticale, «pivotale». Ils ont élaboré une conception autoritaire et moraliste de la féminité, en corrélation avec un ordre social. Ainsi, dans les zones sous leur contrôle, ils appliquaient des sanctions contre des femmes qu’ils percevaient ou jugeaient dans la transgression. Celles qui sont soupçonnées de participer à des fêtes par exemple subissent des humiliations publiques. Elles étaient tondues, comme en France au moment de Libération.
De quelles autres violences les femmes sont-elles victimes?
Beaucoup d’entre elles ont souffert de torture et de conditions de détentions sordides. Ces faits ont encore du mal à être reconnus dans la région Caraïbe. Il s’y ajoute des violences sexuelles que je qualifierai «d’opportunistes». Ce sont par exemple des paramilitaires qui se rendent coupables de viols collectifs sur des jeunes filles à partir de 12 ans, raflées à la sortie de l’école.
Que prévoient les lois?
Les discours de justification des hommes sont ahurissants. Ils disent en substance «elles nous cherchaient car nous sommes les plus beaux». On ne peut pas dire que ces comportements sont seulement le produit d’une culture machiste autoritaire et patriarcale conjuguée à une vision conservatrice de la société. Mais la Cour constitutionnelle a reconnu un crime de «violences sexuelles féroces». D’autre part, cela n’exonère pas de leurs responsabilités les chefs de ces hommes.
Retrouve-t-on un modèle similaire dans la guérilla?
La vision est différente, mais n’exclut pas les rapports d’autorité. Puisque les femmes engagées dans la guérilla sont forcées à prendre des mesures contraceptives. Et celles qui tombaient enceintes se voyaient contraintes à l’avortement, ce qui a causé un grand scandale en Colombie. On a donc affaire à une autre forme de violence. Les Farc ont beau se revendiquer révolutionnaires et progressistes, on voit quand même s’élaborer un rapport autoritaire et vertical. Ainsi, des femmes s’engageaient sentimentalement avec un homme pour se protéger des autres…
Le recrutement de ces femmes est-il volontaire ou forcé?
Les deux cas peuvent se rencontrer. La guérilla, c’est la possibilité pour elles d’échapper à leur propre univers de violence domestique. C‘est aussi un espoir politique et la possibilité d’obtenir, hélas, cette forme de respect que procurent les armes.
Le sort réservé aux femmes est-il sans espoir?
Les femmes s’organisent pour obtenir réparation. Elles se retrouvent responsables de jeunes enfants alors que les pères sont absents ou ne répondent pas. La constitution de 1991 leur garantit plus de droits. La loi qui traite des violences faites aux femmes a été largement dépoussiérée. La coopération internationale apporte une aide. Les Allemands forment ainsi les juges à être moins sexistes. Le discours féministe se pollinise, se diffuse peu à peu grâce au travail des associations qui agissent en réseau pour développer l‘aide judiciaire, faire du lobbying politique ou même être présentes dans des zones de violences sexuelles.
Ma tristesse est horrible
Le témoignage de Alicia Edith A., mère déplacée
La quarantaine, le teint couleur de café doux, les yeux sombres et le regard velouté, Alicia Edith A., mère de sept enfants, est revenue à Bogotá, où elle est née, poussée par un conflit qui la dépasse. Une guerre dont elle a payé le prix fort et dont elle acquittera sans fin les intérêts, à coups de pleurs versés à chaque évocation de ses souvenirs douloureux.
«A 17 ans, j’ai quitté Bogotá pour rejoindre mes grands-parents dans la province de Meta. J’aimais la vie rurale, le travail des champs. Un jour, près de chez nous, l’armée et la guérilla se sont battues pendant deux jours. Un de mes fils âgé de 5 ans a été tué dans les combats. J’ai dû fuir dans un autre village. Là, la guérilla enrôlait de force les garçons entre 12 et 14 ans. Elle m’a emporté un fils de 10 ans et ce fut encore une grande douleur», explique-t-elle, sanglots dans la voix, cœur brisé et mains tremblantes.
Jusqu’à regagner la capitale, son itinéraire est un chemin de croix jalonné du deuil d’une autre fille, d’ultimatums d’hommes en armes la rançonnant et la sommant de déguerpir dans les cinq minutes, de fuite éperdue avec un bébé dans les bras et d’interrogations sans réponse. «Ma tristesse est horrible. J’aimais la campagne, je n’ai jamais rien fait de mal et je voudrais savoir pourquoi on me fait souffrir de cette façon», implore-t-elle dans le chaos d’une vie en vrac.
Aujourd’hui, elle est grand-mère car deux de ses filles sont des mères mineures et célibataires. Toutes trois bénéficient maintenant de l’appui de la fondation suisse Bambi. Son foyer de Bogotá accueille les petits-enfants. Et, elle-même, grâce à Bambi, a pu suivre une formation de couture. Elle a été aidée pour l’acquisition d’une machine, et d’une paire de lunettes qu’elle manipule comme un trésor. Une autre vie s’esquisse grâce au travail à domicile. Une autre vie où, même si elle trouve «difficile de lutter» contre tant d’adversité, Alicia Edith avoue aussi chercher «comment pardonner» et «comment me pardonner». Parce qu’il lui reste une forme de culpabilité. Celle d’être déchirée par la protection de ses plus jeunes enfants et l’éloignement d’un plus grand, resté dans une petite ferme, car «il ne supporte pas la ville et dit qu’il ne sait rien faire». Epuisée par un témoignage qui réactive toute la douleur des émotions passées, elle constate d’un ton las que «ce conflit est aussi horrible que sa répression est terrible».
Demande croissante pour le «bio»
Il existe déjà une quinzaine de magasins dits «biologiques» à Phnom Penh*. Les onze arcades de l’ONG CEDAC vendent pour leur part la production du Farmer Natural Net (FNN), un réseau de paysans dont les cultures sont exemptes de produits chimiques. La fréquentation de ces échoppes bio croît à vue d’œil, même si elles sont encore minoritaires sur le marché. Mais la demande est telle qu’elle devient de plus en plus difficile à absorber, relève Pan Sopheap, du FNN.
Depuis un an, Sukun Thiri est une cliente régulière. Elle ne va plus du tout au marché traditionnel parce qu’elle a peur des substances chimiques. Etant de la province, la jeune femme a déjà surpris des agriculteurs utiliser des produits autour de sa maison. Elle se rend donc en ville pour acheter de la viande de porc et des légumes. «Je me sens rassurée maintenant.»
De son côté, Mala a découvert l’existence des magasins bio à la télévision. Elle les fréquente depuis l’ouverture du premier il y a deux ans. Elle apprécie particulièrement le goût des aliments. «La viande du marché n’est pas bonne. Ici, le goût est très différent. C’est rassurant.» Du coup, elle en parle partout autour d’elle. De plus en plus de monde vient au magasin. «Les légumes partent très vite, il faut venir tôt», sourit-elle.
Reste que les produits biologiques sont encore loin d’être accessibles à toutes les bourses. Le prix du kilo de riz est plus cher qu’au marché: 1 dollar au CEDAC, quand il n’est que de quelques dizaines de cents dans la rue. PCA
*Le terme «biologique» est à prendre avec précaution. A ce jour, il n’existe aucune instance de contrôle et de certification biologique au Cambodge.