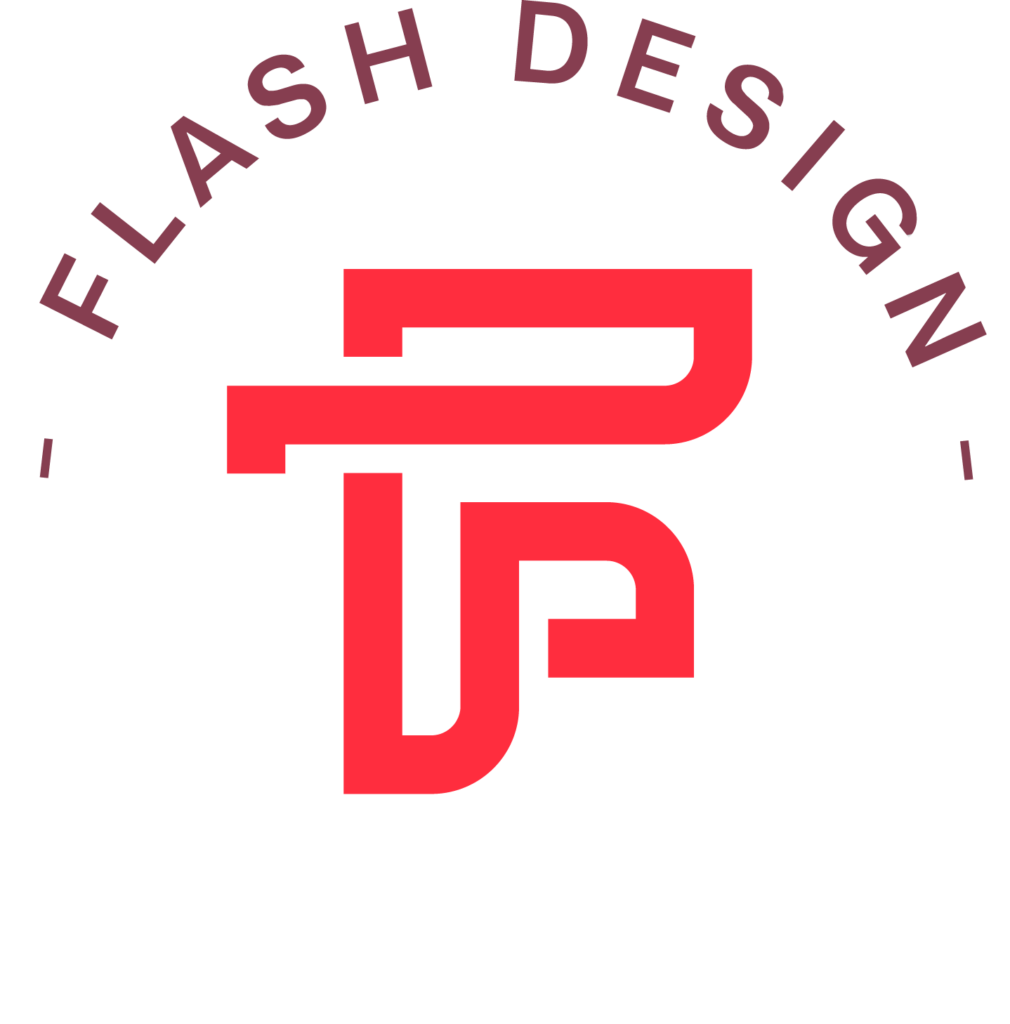LE REPORTAGE DE PAULINE CANCELA A PHNOM PENH

Pak Choeun habite au milieu des rizières. Sa baraque en bois marque l’entrée d’un petit village de la province de Ta Khmau au sud de Phnom Penh. Derrière lui, une dizaine d’autres maisons faites de bric et de broc abritent les membres de sa famille et quelques amis. Tous produisent du riz, mais pour leur consommation uniquement. De son improbable étable, qui abrite une seule et unique vache, Pak Choeun sort un vieux paquet d’engrais. On y lit vaguement «phosphate» et «sodium». Le reste est en filipino.
Etiquettes incompréhensibles
«Je sais que c’est un produit fabriqué aux Philippines», précise le chef de famille un peu décontenancé de ne pouvoir en dire plus. Il l’a acheté au marché local, par mimétisme. «Je ne sais pas l’utiliser, finit-il par avouer. Mais tout le monde le fait ici!»
«Dans 95% des cas, les étiquettes sont en langue étrangère. Parfois, les substances sont même passées de date», atteste Keam Makarady, du Centre d’étude et de développement agricole cambodgien (CEDAC). Pourtant, leur composition devrait être traduite en khmer, selon la loi cambodgienne. Le cas de Pak Choeun est loin d’être isolé. En témoigne une famille pauvre de pêcheurs au bord de la rivière du Tonlé Sap. Dans la province de Siem Reap, dans le sud-ouest du Cambodge, ils sont nombreux à s’installer dans des cahutes à même la rive. Sur le lac, des villages entiers de pêcheurs flottent dans la mangrove.
Dans une vieille bassine, les femmes lavent la prise du jour et l’arrosent d’une sorte de poudre blanche. Elles n’ont jamais entendu parler du borax, ce sel toxique retrouvé sur les étals de Phnom Penh. Ici, rien n’a filtré du scandale de la capitale. En revanche, le paquet de «sel» vide à leurs pieds les laisse perplexes. Rien n’apparaît en khmer, ce pourrait être n’importe quoi. Tous les jours, des millions de paysans comme ces pêcheurs du Tonlé Sap utilisent des produits dont ils ne connaissent les risques qu’en partie. Et auxquels ils sont les premiers à être exposés. Maux de tête, vomissements, «coma parfois», tels sont les fléaux qui assaillent couramment les campagnes du royaume. «Bien que des alternatives existent, regrette Keam Makarady, ils continuent de penser qu’ils n’ont pas le choix. Et lorsque nous les enjoignons à porter un équipement de protection, ils disent qu’il fait trop chaud.»
Mais un couple d’agriculteurs, qui détient une microscopique exploitation sur le Mékong au sud de Phnom Penh, fait l’effort. Sa chance est d’être à proximité de la capitale et de bénéficier de la visite régulière des agents du Ministère de l’agriculture. Ils n’ont donc plus peur des produits, car ils portent gants, masques, bottes et imperméables. «On attend toujours quelques jours après la vaporisation avant de manger nos fruits. Après, le produit s’envole, non?» Dans les faits, Po Minhiam et Vahn Uon n’en ont aucune idée. «On préférerait se passer de pesticides, raconte la jeune femme. Malheureusement, ce n’est pas possible. Sans cela, nos récoltes, déjà minces, seraient détruites et on ne pourrait rien vendre à Phnom Penh.» La petite part qu’ils dégagent comble à peine leurs besoins.
Une agriculture de subsistance
Tous les produits en cause ne seraient pas aussi nocifs pour la santé s’ils étaient utilisés dans des quantités raisonnables et bien distingués les uns des autres. «Il en ajoutent encore au moment de la récolte!» s’étonne M. Makarady.
La majorité de la production cambodgienne est une agriculture de subsistance, qui englobe des exploitations de 1,2 hectare en moyenne. La population rurale, déjà très précarisée par l’histoire du pays, est par conséquent la première victime de l’importation des pesticides.