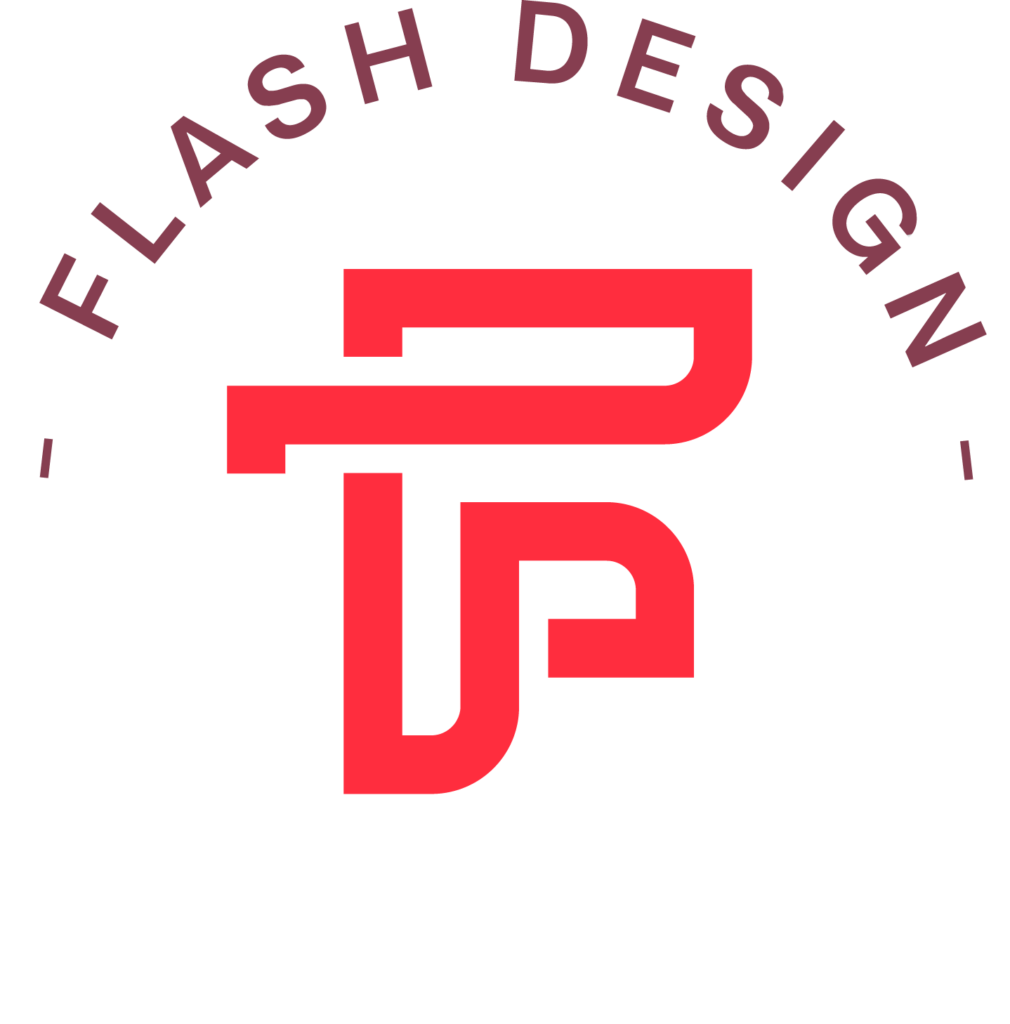Alors que l’agriculture fournit 40% des emplois au Maroc, les autorités misent sur de nouvelles techniques d’irrigation et le dessalement d’eau de mer pour maintenir la production.
Reportage de Julie Jeannet/Le Courrier. Collaboration Rime Taybouta

Stress hydrique
Lorsqu’il ne pleut plus au Maroc, les petit·es paysan·nes en paient un lourd tribut. Une situation dangereuse dans un pays où l’agriculture fournit environ 40% de tous les emplois et génère 14% du PIB. D’après les autorités marocaines, l’agriculture a reçu environ un tiers de moins de la part d’eau qui lui est normalement allouée pour l’irrigation. La zone du bassin de Oum Errabia, dans la province de Beni Mellal, au centre du pays est particulièrement touchée. «Deux cent mille hectares de terres agricoles sont menacées car les nappes phréatiques ont déjà été mises à rude contribution», expose Mohammed Belgheti, adjoint du directeur de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole au Ministère de l’agriculture.
A l’échelle nationale, de gros moyens ont été investis pour moderniser les systèmes d’irrigation. Cinq cent mille hectares ont été équipés d’arrosage par goutte-à-goutte via des subventions étatiques. «En évitant l’évaporation, nous réduisons l’apport d’eau de moitié et augmentons la productivité au mètre carré sur les surfaces maraîchères et les vergers d’agrumes», résume le responsable du Ministère de l’agriculture. Samira qui vit à Oulad Ayad dans le centre du Maroc n’en n’a pas vu la couleur. «Le goutte-à-goutte c’est pour les riches. Même avec des subventions, nous ne pourrions jamais y accéder», déplore-t-elle. «Il faut avoir un puits relié à une nappe phréatique encore alimentée. Chez nous, elles sont asséchées.»
Des nappes à sec
Chercheuse à l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève, Imane Messaoudi-Mattei a étudié durant de longues années la modification des espaces ruraux dans le contexte de raréfaction de l’eau au Maroc. «Il n’est plus rare de voir des agriculteur devoir creuser des forages à plus de 200 mètres de profondeur pour chercher de l’eau», déplore-t-elle. «Nous observons un écart important entre quelques gros investisseurs, dotés de moyens financiers leur permettant de continuer à forer à des profondeurs de plus en plus importantes et de s’accaparer le peu de ressources encore disponibles, et d’autres petits agriculteurs majoritaires pour lesquels la situation devient de plus en plus difficile.»
La spécialiste constate que malgré le manque d’eau, le modèle d’agriculture intensive n’est pas remis en question. «L’agriculture a été placée au centre des enjeux de développement ces trente dernières années. On a encouragé une agriculture intensive irriguée, destinée à l’exportation. Suite aux sécheresses, les niveaux de production sont devenus de plus en plus insuffisants, et les revenus des agriculteurs ne cessent de baisser», relève-t-elle.
Les autorités incitent aujourd’hui les agriculteur·ices à se tourner vers des cultures moins gourmandes en eau ou moins sujette à la météo. En 2022, elles ont cessé de subventionner les cultures d’agrumes, d’avocats et de pastèques. Elles souhaitent aussi réduire les céréales sensibles aux aléas climatiques et favoriser les oliviers. Pourtant cette culture n’échappe pas non plus à une pluviométrie capricieuse. Entre 2021 et 2022, la production a chuté de 40% et les résultats de 2023 s’annoncent encore plus alarmants. La famille de Samira a récolté si peu d’olives en 2023 qu’elle n’a même pas pu produire d’huile de sa propre consommation. Un litre coûte désormais 100 dirhams (8,65 francs suisses). Afin de juguler la hausse des prix de cet ingrédient incontournable de la cuisine marocaine, les exportations sont désormais soumises à autorisation.
La mer au secours
Afin de sécuriser l’approvisionnement, le Maroc compte également dessaler l’eau de mer. Une vingtaine de stations devraient être opérationnelles sur les côtes, à l’horizon 2027. Elles devraient produire 1,3 milliards de mètres cubes par an. Basé sur le processus d’osmose inverse, quatre kWh d’électricité sont en moyenne nécessaire pour dessaler un mètre cube. Pour répondre à ces nouveaux besoins énergétiques, de grandes installations solaires et éoliennes seront installées dans le sud.
Pourtant, de plus en plus de rapports alertent sur les menaces du dessalement pour l’équilibre des milieux marins. Dessaler l’eau implique ensuite le rejet des saumures qui modifient la composition de l’eau. Un taux d’oxygène moindre réduit aussi la capacité d’absorption du CO2 et participe ainsi au réchauffement des océans. Au Maroc, les autorités se veulent pourtant rassurantes. «Des études d’impacts ont été faites pour identifier les courants marins afin de déverser les saumures pour qu’elles soient diluées rapidement et amortir ainsi l’impact sur la faune. Des recherches sont également en cours afin de trouver un moyen de valoriser ces saumures au lieu de les rejeter», explique le responsable de l’hydraulique au Ministère de l’équipement et de l’eau, sans donner davantage de détails.
«Le Maroc brandit la baguette magique de l’innovation technologique», commente Imane Messaoudi-Mattei de l’Université de Genève. «Pour apporter de l’eau, on construit encore de nouveaux barrages, alors que les taux de remplissage moyens ne dépassent pas actuellement les 23%. Beaucoup de choses sont faites, mais la question du coût économique, environnemental et social n’est pas posée.»
Ces méga chantiers suffiront-ils à sécuriser l’approvisionnement en eau de la population du royaume? Si oui jusqu’à quand? Cet été, à Oulad Ayad, Samira affirme être descendue dans la rue pour réclamer de l’eau, mais n’a jamais obtenu de réponse des autorités. Au ministère de l’Equipement et de l’eau, on assure qu’aucune région du Royaume ne sera oubliée. «Assurer l’eau partout relève d’une nécessité pour maintenir l’ordre public. Nous devons aller la chercher et l’acheminer coûte que coûte», affirme le Directeur Général de l’Hydraulique.
On transfère l’eau vers les villes
La chercheuse Imane Messaoudi-Mattei observe d’un œil critique la gestion de l’eau par son pays. Les politiques agricoles mises en place accroissent les inégalités, selon elle.
Propos recueillis par Julie Jeannet/Le Courrier

Imane Messaoudi-Mattei (photo GWH) est chercheuse à l’Université de Genève au sein de l’Institut des Sciences de l’Environnement et du Geneva Water Hub, centre de compétences sur l’eau et la paix. Elle étudie depuis plusieurs années les processus de modernisation des espaces ruraux au Maroc, dans un contexte de surexploitation des ressources hydriques. Elle constate que les politiques mises en place pour lutter contre le stress hydrique accentuent les inégalités entre petits paysans et riches investisseurs et impactent les dynamiques démographiques des régions rurales.
Depuis six ans, les années sèches se succèdent au Maroc. Beaucoup de personnes quittent leurs terres, pouvons-nous parler d’exode rural?
Dans une certaine mesure oui, mais les dynamiques démographiques sont complexes. Dans la province de Beni Mellal, la proximité de Marrakech facilite particulièrement ce mouvement car il y a beaucoup de demandes de services dans le secteur du tourisme. Mais, quitter sa terre pour la ville n’est pas si simple que ça, et trouver un travail en ville n’est plus chose évidente. À El Hajeb, au Sud de Meknès où j’ai travaillé durant mes années de thèse, les agriculteurs ont été contraints de revendre une grande partie de leurs terres. Ceci afin d’obtenir du capital pour approfondir leurs puits et leurs forages et continuer à irriguer. Ces terres ont été accaparées par des investisseurs venus de la ville pour profiter des subventions et avantages promis aux grandes exploitations agricoles. Certains paysans ont même vendu la totalité de leurs parcelles et se sont retrouvés à travailler en tant qu’ouvriers chez leurs acheteurs, à défaut d’autres alternatives en ville.
Les changements démographiques s’opèrent aussi au sein des campagnes mêmes?
Oui. L’encouragement de l’entreprenariat et de la «modernisation» des structures agricoles a amené nombre de jeunes ruraux à travailler chez ces investisseurs pour ne pas avoir à quitter les terres de leurs parents. On peut observer aujourd’hui des formes d’interdépendance entre ces différents groupes qui expliquent pourquoi il n’est plus si simple de partir, malgré la précarisation d’une grande partie de la population rurale.
L’agriculture représente 14% du PIB et 40% des emplois au Maroc, les autorités n’envisagent absolument pas de limiter l’exportation de denrées agricoles pour économiser l’eau?
Non. Ce qui rend le manque d’eau d’autant plus problématique. Le modèle d’agriculture n’est pas remis en question. L’idée est toujours d’encourager une agriculture intensive et irriguée, destinée à l’exportation, au détriment des productions qui constituent le cœur de l’alimentation des Marocain·nes, comme les céréales. En passant à la monoculture irriguée, les familles doivent désormais acheter une grande partie de leur nourriture, alors que par le passé une bonne partie de la production était destinée à l’autoconsommation. Les jeunes doivent multiplier les petits boulots pour survivre, nous sommes très loin de la sécurité alimentaire.
L’approvisionnement en eau potable des villes est la grande priorité de l’Etat.
Oui. L’autoroute de l’eau est un exemple intéressant. On la voit d’abord comme une prouesse technologique, mais ce choix politique conduit au renforcement des inégalités. On prend l’eau des campagnes, en l’occurrence du bassin de Sebou, dont aucune donnée ne permet de dire aujourd’hui qu’il est excédentaire, pour approvisionner les villes de Rabat et de Casablanca. On veut que l’agriculture soit le moteur du développement du pays, on choisit une agriculture irriguée, mais on transfère le peu d’eau qu’il reste dans les campagnes vers les villes.
Les politiques étatiques pour lutter contre le stress hydrique creusent donc encore davantage ces inégalités?
Oui, les politiques agricoles que le pays a choisies renforcent la précarisation d’une grande partie de la population rurale et creusent davantage les inégalités économiques. La gestion de l’eau est réduite à une sécurisation de la disponibilité des ressources se concentrant uniquement sur l’offre. En se focalisant principalement sur les prouesses technologiques pour résoudre les problèmes liés à l’eau, ces politiques oublient que les solutions doivent d’abord être indissociablement environnementales et sociales.