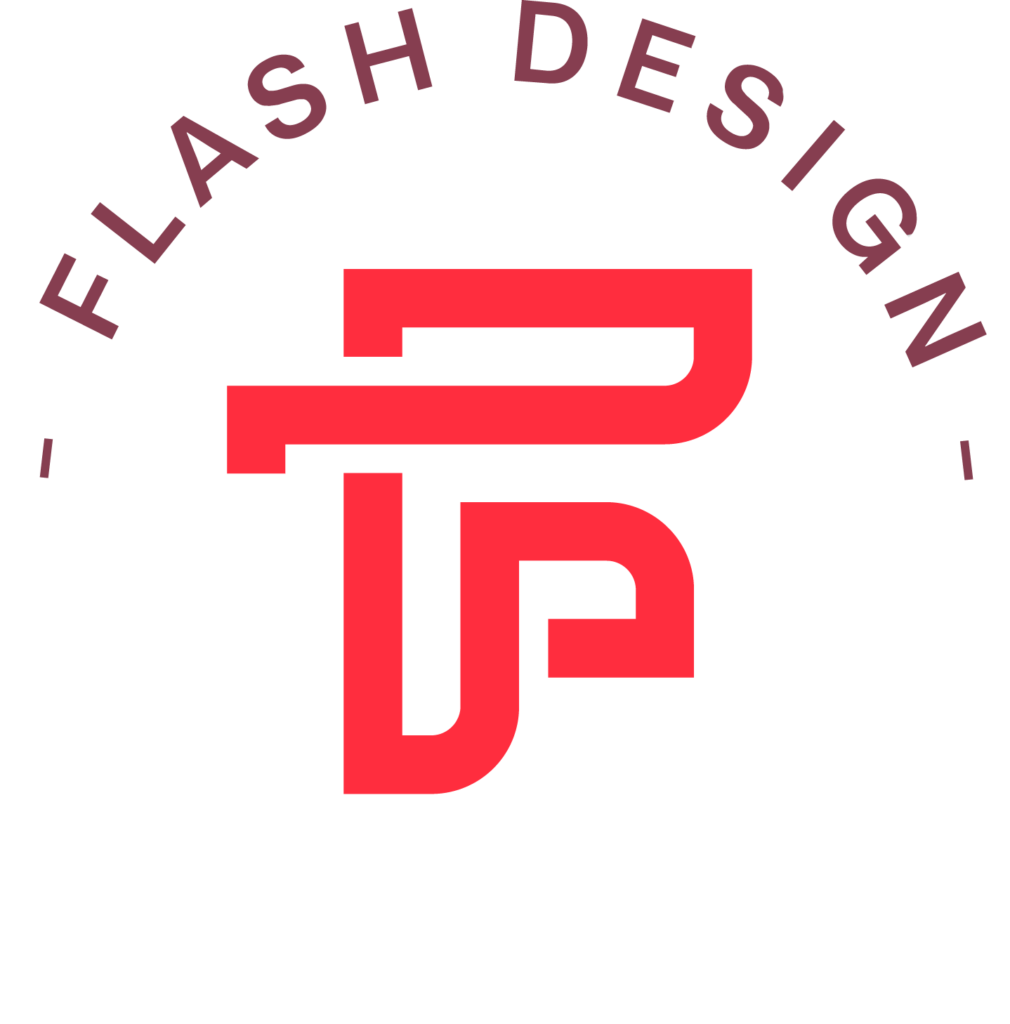UN REPORTAGE AU MALI DE BAYRON SCHWYN
Tabous, honte, pression sociale, les violences faites aux femmes maliennes sont rarement dénoncées. Même de graves délits sont réglés «à l’amiable». Suite de notre reportage à Bamako.
«Je peux vous garantir que derrière tous les divorces que vous verrez devant un tribunal, plusieurs interventions ont été faites en amont pour essayer de sauver l’union. Quels que soient les motifs de la séparation.» Au Mali, on appelle ça la médiation. Le maître mot pour résoudre les conflits.
On la pratique pour tous types de problèmes: lorsqu’une femme est boycottée par les parents de son conjoint et qu’ils refusent de manger les repas qu’elle prépare. Lorsqu’une des femmes estime que son mari privilégie une autre épouse du foyer. Lorsqu’une femme subit des coups répétés. Et même en cas de viols.
Une avocate dédiée
Une façon d’arranger les choses discrètement, pour éviter honte, mise à l’écart ou séparation. Cette forte pression sociale, Diakaria Traoré la constate au quotidien. Depuis 2007, il s’occupe des auditions au sein de la clinique juridique de l’association Deme So, un lieu qui fournit une assistance gratuite à environ 200 dames par an. Les violences faites aux femmes occupent une large part des activités: une des trois avocates employées ne s’occupe que de ce genre de cas.
La moitié des dossiers traités par Deme So sont réglés à l’amiable. Un leader religieux, les parents, les proches: les interventions sont multiples. «Cela fait partie de notre culture, personne ne veut assister à un divorce, tout le monde essaie de trouver une solution pour qu’on n’en arrive pas là», souligne Diakaria Traoré. «Quand tu traînes une personne en justice, les liens sont rompus à jamais. Les femmes préfèrent supporter leur mari et prendre leur mal en patience.»
Ce rôle de médiateur sied à l’association: «C’est aussi pour cela que nous sommes là. Pour ceux qui préfèrent chercher un terrain d’entente, au lieu d’aller à la police ou à la justice.»
Le mariage a une importance telle que même les organisations les plus militantes n’encouragent pas directement à passer par la justice. Par peur d’être accusées de pousser à la séparation, comme l’association Deme So. «Malheureusement, davantage de femmes viennent chez nous. Ces trois dernières années, nous constatons une augmentation de 15 à 20% par an. Cela nous met mal à l’aise, au point que l’on nous qualifie de clinique des divorces. C’est vraiment une mauvaise connotation», confie Diakaria Traoré.
«Nous sommes là pour sauver le couple»
Les centres d’accueil – qu’ils soient gérés par la police nationale ou un mouvement féministe – et même les procureurs pratiquent la médiation en priorité. «Nous jouons un rôle d’interface entre la justice et la population», explique Diawara Bintou Coulibaly, présidente de l’Association pour le progrès et le droit des femmes, qui gère des dizaines de cas par mois. Elle insiste longuement: «Ce sont les femmes qui décident d’aller porter plainte ou de divorcer, nous n’encourageons personne à aller en justice, nous sommes là pour sauver le couple.» Elle reprend: «Mais une fois qu’elles ont fait les démarches, nous les accompagnons.»
Aller en justice, c’est s’exposer à de nouvelles difficultés. «La femme se retrouve seule et lorsque des pensions alimentaires sont demandées, le mari refuse de payer la plupart du temps», illustre Ramatoullahi Coulibaly, substitut du procureur au Tribunal de première instance de la Commune VI, à Bamako.
Même lorsqu’il s’agit de viols, les femmes sont poussées au silence: «Les parents ne veulent pas qu’on sache que leur enfant a subi un viol. Mais, lors d’une audience publique, tout le monde est au courant», note la commissaire principale de police Assitan Traoré.
Le dilemme est connu des associations de promotion et de protection du droit des femmes. Le réseau Wildaf milite en ce sens pour améliorer la confidentialité des procès. Le huis clos sera-t-il la solution miracle?Comme beaucoup d’autres associations, la structure compte sur des bailleurs de fonds étrangers: Terre des femmes, ONU Femmes, Unicef, Etat du Canada, la liste est longue, mais insuffisante pour répondre à tous les besoins.