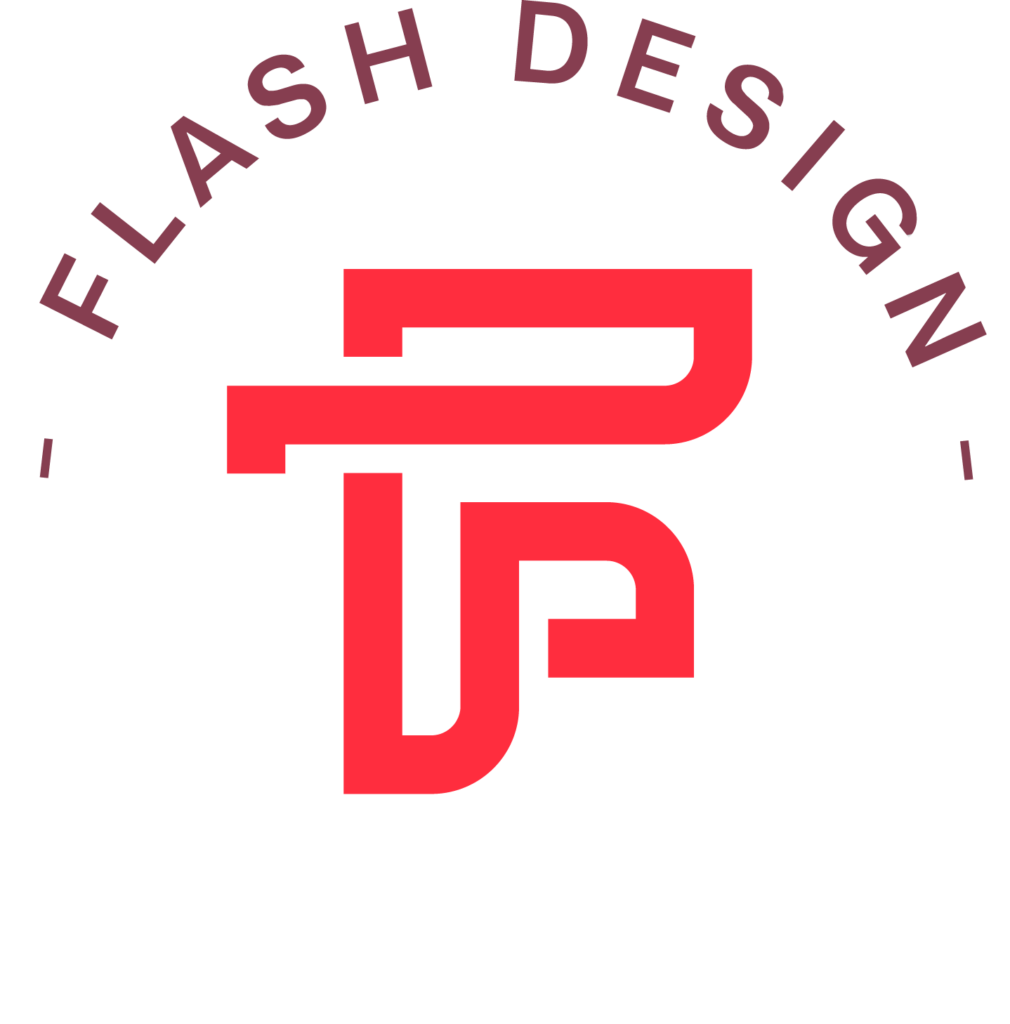UN REPORTAGE EN SUISSE DE ACHERIF AG ISMAGUEL
En Suisse, comme partout dans le monde, les femmes sont victimes de violences conjugales : physiques, psychologiques, verbales, sexuelles ou économiques. En Suisse romande (La Suisse francophone), les actions conjuguées des autorités et des structures d’aide prennent le phénomène à bras le corps. Pendant que les lois répriment, l’assistance aux victimes et aux auteurs permet de réduire les statistiques. Une lutte herculéenne qui est sur de bons rails.
« Deux femmes meurent chaque mois en Suisse sous les coups de leurs maris. Un chiffre assez stable », introduit Nicole Baur, cheffe de l’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE). Dans son bureau sur les hauteurs de Neuchâtel, un canton suisse autonome, Madame Baur est au centre des activités de lutte contre les violences conjugales et familiales. Dans une Confédération helvétique où une réelle paix civile règne, la question des violences conjugales est sensible, bien que le taux des victimes soit moins bas qu’ailleurs en Europe. Ce phénomène séculaire se définit comme un « ensemble de comportements, de paroles ou de gestes agressifs, brusques et répétés à l’intérieur d’une relation de couple ou de relations familiales. Cette violence peut être physique, psychologique, verbale, sexuelle ou économique et peut se manifester par des abus faits aux enfants, le contrôle de l’argent et des mesures visant à contrôler les gestes et comportements d’un ou plusieurs membres de la famille », souligne une notice du Centre d’accueil Malley Prairie de Lausanne.
Une prise de conscience du phénomène émerge dans cette société, où la violence touche aussi bien les femmes que les hommes.
« En Suisse, comme partout ailleurs, les violences conjugales sont très présentes dans les familles et en grande partie cachées. Nous avons estimé dans le canton de Neuchâtel à 500 par année les interventions de l’un ou l’autre des acteurs entrant dans le processus de protection, dénonciation ou punition. Mais cela n’est que la partie visible de l’iceberg », affirme Nicole Baur, selon laquelle des études ont montré que les cas de violences conjugales révélés ne représentent que 10% des violences réelles.
Pour Christian Anglada, codirecteur du Centre de prévention de l’Ale et de Malley Prairie à Lausanne, l’iceberg est la partie que les medias évoquent peu lorsqu’un crime particulièrement sordide fait la Une des journaux. « Toute une partie de la violence conjugale est invisibilisée par les medias, qui parlent à tort de « drame familial » ou de « coup de folie », laissant croire que seules des personnes souffrant de démence mentale ou de perversion ont recours à ces violences, ce qui existe certes, mais reste l’exception », souligne-t-il.
Un processus fatal
Un sujet complexe et à multiples formes. Ses causes sont parfois banales et parfois profondes. Dans les couples, tout commence par une obsession de contrôler l’autre et de le dominer. « Il s’agit le plus souvent d’auteurs qui ne parvient pas à exprimer leur frustration autrement que par des coups. Cette violence découle de toujours la volonté de l’auteur (qui peut aussi être une femme, mais c’est beaucoup plus rare) de contrôler sa victime, de considérer qu’elle lui appartient, qu’elle est sa chose », fait savoir la figure de proue de la lutte dans le canton. Un climat délétère s’installe alors dans le foyer. « C’est très souvent une dynamique qui se crée dans le couple et cela devient un enjeu d’avoir le dernier mot, d’avoir une position forte par rapport à l’autre. Du coup, les deux se mettent à tour de rôle dans la position de victime ou d’auteur », ajoute Hilde Stein, psychologue – psychothérapeute au Service pour auteur de violence conjugale (SAVC) du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).
Cette atmosphère électrique consume pas à pas la relation du couple, qui se brise faute de dépassement. « Dans un premier temps, la tension monte. L’auteur frappe, puis s’excuse. Puis vient une phase de « lune de miel » et le cycle infernal reprend », schématise la cheffe de l’Office de la politique familiale et de l’égalité de Neuchâtel. Elle ajoute « souvent, ce n’est que lorsque l’auteur fait le geste de trop que la victime s’en va. Parfois, c’est trop tard », regrette la déléguée à la politique familiale et à l’égalité.
Car l’attachement de la victime à son conjoint découle d’un espoir de le voir changer. Elle se retrouve dans un dilemme cornélien jusqu’au coup fatal. Selon Christian Anglada, cela fait partie du processus et « s’explique facilement pour des raisons affectives liées à l’accès aux enfants et au maintien de la cellule familiale. Et des raisons administratives, liées au statut de séjour, qui peut dépendre du conjoint, entrent aussi souvent en ligne de compte ».
Face à toutes ces pesanteurs, l’autonomisation des femmes devient de plus en plus l’alternative. Certaines victimes sont contraintes de subir des violences par ce que l’horizon est bouché et l’aventure incertaine. « Si une femme est autonome financièrement, qu’elle a sa propre vie sociale, ce sera beaucoup plus facile pour elle de se libérer de l’emprise de la personne qui la maintient sous sa domination », explique Nicole Baur.
Arsenal répressif
« La femme en Suisse est plus en danger à la maison que dans la rue », professe Georges André Lozouet, chargé de communication de la Police de Neuchâtel. Un constat glaçant. C’est pourquoi les autorités fédérales et cantonales ont mis en place un arsenal juridique qui réprime les auteurs et protège par la même occasion les victimes.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur les violences dans le couple (LV Couple), instaurée en 2004, renforce les mesures préventives déjà en vigueur. « Elle prévoit de protéger les victimes en créant notamment des foyers et exige des auteurs de violences qu’ils soient suivis, en intégrant par exemple des groupes de parole. La législation fédérale prévoit aussi que les cas de violences conjugales soient poursuivis d’office. Elle a introduit la possibilité d’éloigner l’auteur du domicile et de lui interdire par exemple de prendre contact avec son ex partenaire », explique la défenseure des droits des femmes. Malgré les recours disponibles, les femmes victimes portent rarement plainte contre leurs partenaires. Elles ont surtout peur de l’inconnu, du changement qui pourrait s’opérer dans leur vie si elles le dénonçaient. « Les victimes sont réticentes à porter plainte parce que cet homme est souvent le père de leurs enfants et qu’elles n’ont aucune indépendance économique. Elles ont aussi honte d’oser dire qu’elles sont des femmes battues et souvent ont encore des liens affectifs très forts avec l’auteur », explique Nicole Baur.
Pour le procureur général Pierre Aubert, du Ministère public de Neuchâtel, « le but n’est pas de punir, mais que la personne auteure comprenne le mal qu’elle a fait ». Les sanctions varient en fonction des infractions. Le procureur affirme que « la peine en elle-même n’est pas utile, mais c’est un excellent levier », ajoutant qu’il y a eu une très nette évolution dans la prise de conscience. Dans ce petit pays de l’Europe centrale, aux maisons à l’apparence médiévale Suisse, les lois priment sur les religions et les cultures.
Structures d’aide
Face aux violences et à leurs conséquences sur les victimes et les auteurs, des structures d’assistance ont été créées. Parmi elles, le Centre d’accueil Malley Prairie de Lausanne. « Nous accueillons 200 femmes chaque année en hébergement et plus de 1 000 autres en consultations ambulatoires. Depuis 2018, cette prestation a été ouverte aux hommes », indique Christian Anglada. Ces femmes, pour la plupart, arrivent en situation de crise et d’urgence suite à une intervention de police ou à une grave agression, après des soins prodigués à l’hôpital. Pour leur reconstruction elles s’engagent à participer à certaines activités, comme des entretiens pour réfléchir sur leur vie. Elles peuvent également être reçues au Centre universitaire romand de médecine légale du CHUV de Lausanne. Dr Nathalie Romain-Glassey, responsable de l’Unité de médecine des violences, s’occupe de ces femmes brisées et procède à des constats et à des évaluations des besoins. Une consultation gratuite est offerte pour une écoute du récit de la victime. « Ce constat médical est une forme de reconnaissance des violences subies », dit celle qui considère ce phénomène comme un problème de santé, « parce qu’il cause des blessures, de la dépression et du suicide ».
Dans la recherche de solutions, les acteurs se sont rendu compte que la lutte passait par la prise en compte des auteurs de violence. « Les auteurs ne pensent pas qu’ils ont besoins d’aide. L’obstacle qu’on rencontre le plus chez eux est le déni total des faits », déclare Hilde Stein. Ils sont accueillis pour comprendre leur situation, puis suivent des entretiens individuels d’évaluation. « Pour nous, aider les auteurs, c’est protéger les victimes », justifie la psychologue.
Ce service les soulage, car il leur permet de parler en groupe de sujets dont ils ne parlent pas ailleurs. La plupart d’entre eux « vivent les lois comme une injustice profonde et ont l’impression qu’elles sont contre eux », explique Hilde Stein. « Quelques-uns pensent que c’est un droit que d’avoir certains comportements en tant que chef de famille ». À cela s’ajoute la différence de cultures mais aussi de religions. Dans les sociétés patriarcales et dans certains pays du monde, le rôle de l’homme est défini de façon différente qu’en Suisse. « Ce matin, nous avons échangé avec quelqu’un d’origine maghrébine qui trouvait totalement inapproprié que sa femme lui refuse des rapports sexuels. En Suisse, elle n’est pas obligée d’accepter », conclut-elle, avec l’approbation de son collègue Marc Glaisen.