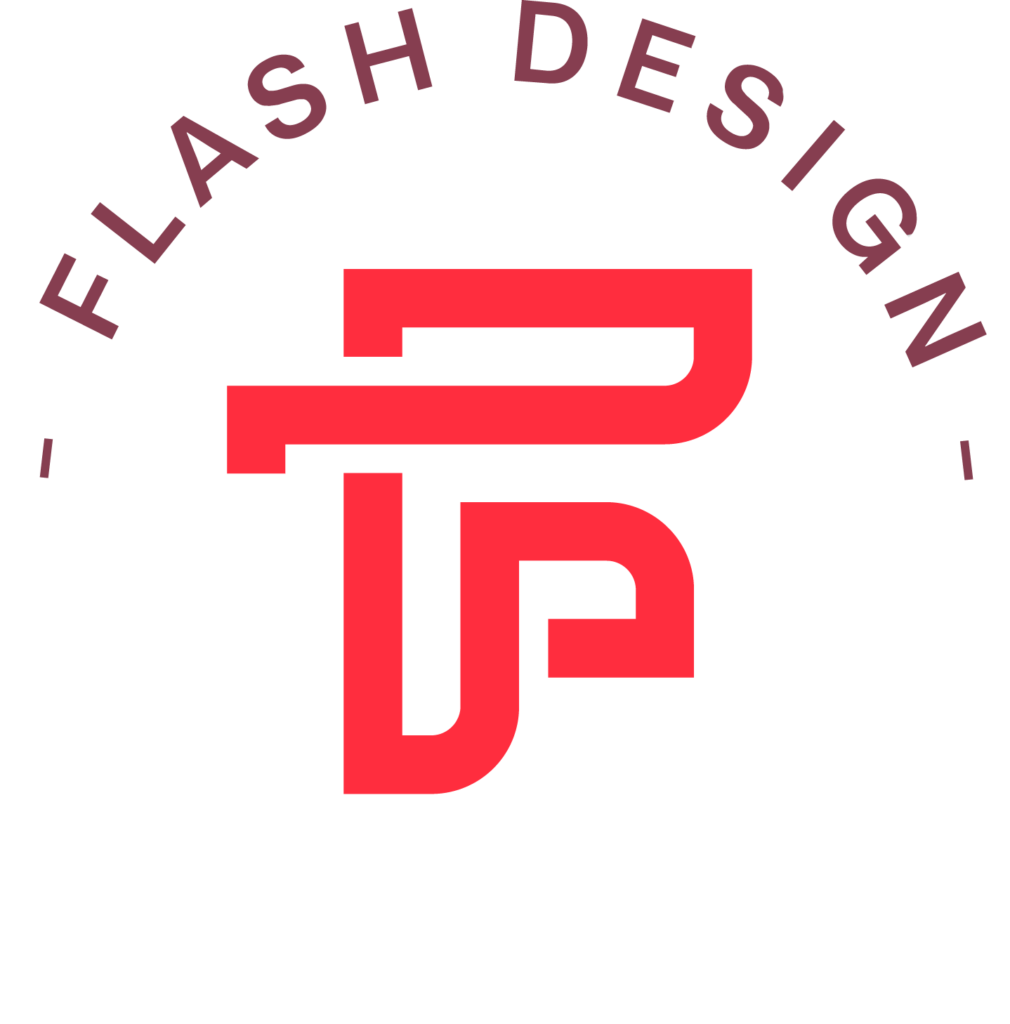UN REPORTAGE DE PHILIPPE VILLARD EN COLOMBIE – MEDIA DE REFERENCE : L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

5,5 millions de personnes, surtout les femmes, ont fui les zones de conflit.
S’il est un leadership mondial dont la Colombie se passerait bien, c’est celui du nombre de personnes déplacées.
Pour 47 millions d’habitants, elles sont près de 5,7 millions à avoir fui les secteurs affectés par le conflit, «soit 95% du pays, car les zones de combat changent pour passer par exemple de la Caraïbe à la côte Pacifique», souligne Marco Romero, directeur du Conseil pour les droits humains et les déplacements (Codhes), organisme spécialisé dans l’étude du phénomène. Malgré la démobilisation de 30’000 paramilitaires entre 2004 et 2006, et des pourparlers de paix engagés à Cuba entre la guérilla marxiste des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (Farc) et le pouvoir, les affrontements continuent. Et les mouvements de population ne tarissent pas.
Vulnérables
Pour les spécialistes de diverses institutions ou organisations non gouvernementales qui suivent de près la question, on ne peut pas parler de flux massifs. Il s’agirait plutôt d’un filet régulier de familles arrachées à leurs zones rurales d’origine et échouées dans les périphéries des grandes cités ou des villes moyennes du pays. De plus, la majeure partie des déplacés sont des déplacées. On recense 65% de femmes, dont 60% sont mères de jeunes enfants. «Cette population dispose d’une culture rurale mais n’a plus la possibilité de vivre à la campagne. Il devient très difficile pour elles de trouver une place dans un milieu urbain qui, faute de solutions économiques, n’offre que du sous-emploi», note Marco Romero. A la vulnérabilité humaine s’ajoute la vulnérabilité économique. «Avant l’exode rural, 50% de ces gens étaient en train de dépasser le seuil de pauvreté et moins de 25% vivaient dans une pauvreté extrême. Après le déplacement, ils sont 95% à vivre sous le seuil de pauvreté et 85% tombent dans une pauvreté extrême», détaille encore Marco Romero.
Tous perdants! Et dans le lot, une majorité de femmes de 18 à 40 ans peu formées et peu qualifiées. «On les a dépossédées de leur terre, mais aussi de leur dignité», estime Olga Amparo Sanchéz Goméz, directrice de la Casa de la mujer (Maison de la femme). Cette structure anime, pilote ou coordonne différentes actions de lobbying en faveur des femmes déplacées, mais aussi des femmes en général. Elle estime que le conflit armé les expose en première ligne: menaces sur les enfants et menaces de violences sexuelles justifient l’exode urbain.
Changement culturel
Des pratiques qui se développent, de surcroît, sur un socle de mentalités machistes qui tend à maintenir les femmes au second plan. Mais le déracinement s’accompagne d’un profond changement culturel. «La femme devient le chef d’une famille parfois élargie aux grands-parents ainsi qu’aux oncles et tantes. Elle endosse des responsabilités sociales et économiques, soit autant de fonctions qu’elle ne remplissait pas auparavant dans l’espace public car elle était cantonnée à la reproduction et aux soins domestiques», analyse Olga Amparo Sanchéz Goméz. Et ce changement de statut s’accompagne souvent de la contestation des jeunes. Ils rejettent cette nouvelle autorité maternelle.
Selon elle, «les garçons cherchent parfois à la récupérer». Adolescents et pré-ados font porter à la mère la culpabilité d’un départ qui s’accompagne pour eux d’une grande perte de repères. Et aussi de valeurs. «Pour les jeunes filles, le risque d’être exposée à la prostitution est accru», s’alarme-t-elle encore. Pour les femmes, cette situation relève «du calvaire». Elles ne sont ni en ville ni en campagne. «Certaines ont envie de revenir sur leurs terres, mais les enfants ne le veulent plus. Ils ont découvert la ville. Enfin, en cas de retour, leur sécurité n’est pas garantie», conclut-elle.
Massive, mouvante, complexe, la réalité des déplacées nourrit travaux, recherches et analyses tandis que les politiques prennent conscience de la nécessité d’agir. Pour une militante comme Olga Amparo Sanchez Gomez, ces situations difficiles démontrent la résilience des femmes.
A ses yeux, les déplacées jettent un pont qui doit permettre aux femmes colombiennes de gagner en autonomie tout en leur rendant la parole car, «quand on parle du conflit, on entend d’abord la voix des hommes!».
Après celle des armes…
COMPLÉMENT D’ARTICLE :
Le discours féministe se pollinise, se diffuse peu à peu
Les femmes colombiennes paient-elles un lourd tribut au conflit?
Si l’on considère les femmes seulement comme victimes, on évacue la dimension politique de la question. Les paramilitaires et la guérilla ont élaboré des visions différentes de la femme.
Qu’en est-il chez les paramilitaires?
Pour les paramilitaires, on dispose d’études et de témoignages recueillis dans la région Caraïbe. Le rôle des hommes et des femmes se structure de manière très verticale, «pivotale». Ils ont élaboré une conception autoritaire et moraliste de la féminité, en corrélation avec un ordre social. Ainsi, dans les zones sous leur contrôle, ils appliquaient des sanctions contre des femmes qu’ils percevaient ou jugeaient dans la transgression. Celles qui sont soupçonnées de participer à des fêtes par exemple subissent des humiliations publiques. Elles étaient tondues, comme en France au moment de Libération.
De quelles autres violences les femmes sont-elles victimes?
Beaucoup d’entre elles ont souffert de torture et de conditions de détentions sordides. Ces faits ont encore du mal à être reconnus dans la région Caraïbe. Il s’y ajoute des violences sexuelles que je qualifierai «d’opportunistes». Ce sont par exemple des paramilitaires qui se rendent coupables de viols collectifs sur des jeunes filles à partir de 12 ans, raflées à la sortie de l’école.
Que prévoient les lois?
Les discours de justification des hommes sont ahurissants. Ils disent en substance «elles nous cherchaient car nous sommes les plus beaux». On ne peut pas dire que ces comportements sont seulement le produit d’une culture machiste autoritaire et patriarcale conjuguée à une vision conservatrice de la société. Mais la Cour constitutionnelle a reconnu un crime de «violences sexuelles féroces». D’autre part, cela n’exonère pas de leurs responsabilités les chefs de ces hommes.
Retrouve-t-on un modèle similaire dans la guérilla?
La vision est différente, mais n’exclut pas les rapports d’autorité. Puisque les femmes engagées dans la guérilla sont forcées à prendre des mesures contraceptives. Et celles qui tombaient enceintes se voyaient contraintes à l’avortement, ce qui a causé un grand scandale en Colombie. On a donc affaire à une autre forme de violence. Les Farc ont beau se revendiquer révolutionnaires et progressistes, on voit quand même s’élaborer un rapport autoritaire et vertical. Ainsi, des femmes s’engageaient sentimentalement avec un homme pour se protéger des autres…
Le recrutement de ces femmes est-il volontaire ou forcé?
Les deux cas peuvent se rencontrer. La guérilla, c’est la possibilité pour elles d’échapper à leur propre univers de violence domestique. C‘est aussi un espoir politique et la possibilité d’obtenir, hélas, cette forme de respect que procurent les armes.
Le sort réservé aux femmes est-il sans espoir?
Les femmes s’organisent pour obtenir réparation. Elles se retrouvent responsables de jeunes enfants alors que les pères sont absents ou ne répondent pas. La constitution de 1991 leur garantit plus de droits. La loi qui traite des violences faites aux femmes a été largement dépoussiérée. La coopération internationale apporte une aide. Les Allemands forment ainsi les juges à être moins sexistes. Le discours féministe se pollinise, se diffuse peu à peu grâce au travail des associations qui agissent en réseau pour développer l‘aide judiciaire, faire du lobbying politique ou même être présentes dans des zones de violences sexuelles.
Ma tristesse est horrible
Le témoignage de Alicia Edith A., mère déplacée
La quarantaine, le teint couleur de café doux, les yeux sombres et le regard velouté, Alicia Edith A., mère de sept enfants, est revenue à Bogotá, où elle est née, poussée par un conflit qui la dépasse. Une guerre dont elle a payé le prix fort et dont elle acquittera sans fin les intérêts, à coups de pleurs versés à chaque évocation de ses souvenirs douloureux.
«A 17 ans, j’ai quitté Bogotá pour rejoindre mes grands-parents dans la province de Meta. J’aimais la vie rurale, le travail des champs. Un jour, près de chez nous, l’armée et la guérilla se sont battues pendant deux jours. Un de mes fils âgé de 5 ans a été tué dans les combats. J’ai dû fuir dans un autre village. Là, la guérilla enrôlait de force les garçons entre 12 et 14 ans. Elle m’a emporté un fils de 10 ans et ce fut encore une grande douleur», explique-t-elle, sanglots dans la voix, cœur brisé et mains tremblantes.
Jusqu’à regagner la capitale, son itinéraire est un chemin de croix jalonné du deuil d’une autre fille, d’ultimatums d’hommes en armes la rançonnant et la sommant de déguerpir dans les cinq minutes, de fuite éperdue avec un bébé dans les bras et d’interrogations sans réponse. «Ma tristesse est horrible. J’aimais la campagne, je n’ai jamais rien fait de mal et je voudrais savoir pourquoi on me fait souffrir de cette façon», implore-t-elle dans le chaos d’une vie en vrac.
Aujourd’hui, elle est grand-mère car deux de ses filles sont des mères mineures et célibataires. Toutes trois bénéficient maintenant de l’appui de la fondation suisse Bambi. Son foyer de Bogotá accueille les petits-enfants. Et, elle-même, grâce à Bambi, a pu suivre une formation de couture. Elle a été aidée pour l’acquisition d’une machine, et d’une paire de lunettes qu’elle manipule comme un trésor. Une autre vie s’esquisse grâce au travail à domicile. Une autre vie où, même si elle trouve «difficile de lutter» contre tant d’adversité, Alicia Edith avoue aussi chercher «comment pardonner» et «comment me pardonner». Parce qu’il lui reste une forme de culpabilité. Celle d’être déchirée par la protection de ses plus jeunes enfants et l’éloignement d’un plus grand, resté dans une petite ferme, car «il ne supporte pas la ville et dit qu’il ne sait rien faire». Epuisée par un témoignage qui réactive toute la douleur des émotions passées, elle constate d’un ton las que «ce conflit est aussi horrible que sa répression est terrible».